2013, une année où l’humain aura sa place au Mali comme ailleurs ?
Dans quelques jours, nous serons le 17 janvier. Un an déjà que le monde découvrait avec effroi les premières images de ce qui se passait au Nord, Aguelhok devenait synonyme de massacre. Mais, rappelons-nous, cela faisait déjà longtemps que les populations du septentrion voyaient venir le danger et l’avaient signalé, en vain. Les frontières étaient poreuses, l’immensité du territoire permettait l’anonymat des trafiquants de tout genre. De nouveaux otages occidentaux venaient d’être capturés.
Le monde découvrait que le MNLA revendiquait l’indépendance des 2/3 du territoire, et semaine après semaine, Gao, Kidal et Tombouctou, les villes aux noms mythiques, devenaient des villes martyres. Des banques et des commerces étaient pillés, des centres de santé et des bâtiments publics étaient détruits, des fillettes et des femmes subissaient des violences inouïes. Le mal était fait. Certains habitants partirent vers le Sud, d’autres se réfugièrent dans les pays voisins. Le Mali commençait à faire la une des médias internationaux. Au matin du 22 mars, le peuple malien et le monde entier furent stupéfaits d’entendre que l’ère ATT était révolue. Bamako commença à s’enliser dans les rivalités politiques alors que les populations du nord qui avaient décidé de ne pas bouger virent leurs vies basculer dans l’effroi. Ils assistaient aux exactions et aux combats entre les groupes armés qui se disputaient le contrôle de leur territoire ancestral.
En juin, les villes de Tombouctou, Kidal et Gao «tombaient», l’une après l’autre, aux mains de AQMI, ANSAR DINE et MUJAO qui avaient chassé le MNLA. L’Etat était parti depuis longtemps. Les populations étaient abandonnées. Le Nord du Mali devenait un territoire occupé. Une phrase commençait à fleurir sur toutes les lèvres comme dans les réseaux sociaux : «il faut récupérer le Nord». Un an donc que le Mali, un et indivisible, alimente les chroniques à l’internationale de la façon la plus effroyable. Et à chaque fois, on rappelle que des otages occidentaux sont retenus depuis longtemps quelque part au Sahel par un de ces groupes armés. On oublie d’expliquer clairement que récupérer le Nord signifie surtout libérer les populations retenues en otages sur leur propre territoire. Pendant des mois, les pays amis du Mali sont témoins immobiles de l’inimaginable. Depuis septembre, nous assistons à une valse-hésitation autour d’une potentielle intervention. De semaine en semaine, le chronogramme est modifié. Le moral du peuple malien plonge. Et dans le septentrion, les groupes qu’on voulait nous faire croire différents agissent de plus en plus ouvertement de concert. Quand on apprend que les premiers responsables de ce désastre sont reçus par Blaise comme par la France, car ils sont «les seuls interlocuteurs possibles», il y a de quoi se poser des questions sur ce qui se cache derrière. Les Maliennes et les Maliens sont en droit de se demander pourquoi ils comptent si peu sur l’échiquier politique international. Les réponses sont sans doute plus machiavéliques qu’on n’ose l’imaginer car cela dépasse largement le Mali, même si le désastre est vécu par le Mali.
Depuis des années, le monde est avant tout guidé par l’argent et les profits, le monde est à la botte des marchés financiers. Les pays du Sud, ce qu’on appelait autrefois le Tiers-Monde, en sont les victimes de toujours, puisque, malgré la richesse de leurs sous-sols, les populations restent les plus pauvres du monde. Nombre de pays européens en subissent aujourd’hui les conséquences. En Grèce comme en Espagne, il a fallu du temps aux populations qui sont touchées par les mesures d’austérité draconiennes pour comprendre que les décideurs politiques choisissent toujours de sauver les banques plutôt que les peuples. Dans cette globalisation néolibérale, le profit est le maître à penser des acteurs politiques. Si on garde bien cela en tête, on entrevoit certaines explications à la crise dite «sécuritaire» au Mali. On comprend pourquoi on a fermé les yeux sur les trafics d’armes et de drogue dans les régions sahéliennes. Cela rapportait et rapporte encore beaucoup, énormément d’argent, et pas aux seuls groupes armés locaux. On comprend pourquoi les multinationales qui exploitent les richesses naturelles de la région ont toutes les facilités pour continuer à le faire.
Il faut donc enfin oser dire, haut et fort, que ce qui se passe depuis un an dans le septentrion n’est pas le fruit du hasard et que le Mali est au cœur d’une affaire globale derrière laquelle règne l’argent-roi. Une certaine interprétation du calendrier maya nous promettait la fin du monde il y a quelques jours. Je veux croire qu’il s’agissait de la fin de ce monde qui préfère le profit aux peuples. Souhaitons que 2013 donne naissance à une nouvelle ère où l’humain aura sa place au Mali comme ailleurs. Souhaitons que 2013 chasse les intrus du septentrion, que les populations se réconcilient et s’entendent pour que le Mali accède à une démocratie politique et sociale pour qu’enfin les Maliens retrouvent leur fierté d’appartenir à ce beau pays !
Françoise WASSERVOGEL
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
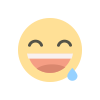 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
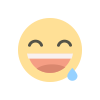 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0







































