Près de 5000 migrants africains refoules vers le Niger : Xénophobie à l’algérienne !
«L'Algérie, comme à ses habitudes, c'est-à-dire au mépris des lois et conventions africaines et internationales, a entrepris de refouler de son territoire, des milliers de ressortissants africains dont des Nigériens», a dénoncé Télé Sahel, la télévision d’État nigérienne.

Plus de la moitié sont des Nigériens, a-t-elle poursuivi. «Du 1er au 21 avril 2025, 2753 nigériens dont 308 mineurs et 196 femmes ont été refoulés», a annoncé Télé Sahel qui cite les responsables sécuritaires d'Assamaka, ville nigérienne frontalière avec l'Algérie. Plus de la moitié sont des Nigériens, a-t-elle précisé. Une déclaration en lien avec le renvoi par Alger de 4975 migrants africains vers les frontières de ce pays voisin depuis début avril. Un convoi de camions transportant 1141 migrants expulsés d’Algérie a atteint, samedi 19 avril, le Point Zéro d’Assamaka, localité nigérienne frontalière.
Selon des sources locales, officiellement, ce groupe hétérogène comprend 41 femmes, 7 filles et 5 garçons, originaires de pays africains et asiatiques. La diversité des nationalités donne une certaine ampleur à cette crise migratoire que l’Algérie amplifie par des expulsions massives vers le Niger, qui n'est pas le seul pays destinataire de ces flux. Car parmi les expulsés figurent : 347 Guinéens dont 14 femmes et 8 enfants ; 287 Maliens dont 6 femmes et 2 enfants ; 87 Ivoiriens ; 70 Béninois ; 54 Burkinabés ; 50 Somaliens dont 16 femmes. Ce "melting-pot de détresses" a pris d'assaut la ville d'Assamaka dans le désert nigérien. «Beaucoup arrivent épuisés, sans vivres ni soins. Les femmes et enfants sont particulièrement vulnérables», alerte un travailleur humanitaire. Cet afflux massif devient récurrent, malgré l’accord bilatéral de 2014 limité aux Nigériens en situation irrégulière en Algérie. Les autorités nigériennes ont dénoncé une violation des procédures par cet unilatéralisme : «Alger refoule toutes les nationalités vers nous, sans coordination», pour mettre le régime de transition sous tension sans aucune alternative humanitaire proposée, sachant que le pays est confrontées à des défis sécuritaires et économiques. Déjà, en juillet 2016, Niamey avait protesté via son ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou, contre ces expulsions «unilatérales et inhumaines».
La même apostrophe a été adressée récemment aux autorités algériennes via le secrétaire général du ministère nigérien des Affaires étrangères qui a convoqué l’ambassadeur algérien à Niamey. Ce dernier a dénoncé des «violences contre des Nigériens refoulés». Preuve que le dossier reste une épine dans les relations entre les deux pays, les migrants, ballottés entre espoir et désillusions, certains galèrent dans le désert, rêvent encore de rejoindre l’Europe, quand d’autres espèrent regagner leur terre d'origine, pendant que cette route du retour est truffée d’incertitudes, d'obstructions et d'épreuves.
Les migrants nigériens «sont arrivés par convois dits officiels», c’est-à-dire à bord de véhicules et accueillis à Assamaka par les autorités locales, en vertu d’accords entre les deux pays, selon la télévision. Dans la même période, ce sont également «2222 refoulés piétons» dont 146 Nigériens et 2076 étrangers qui sont arrivés à Assamaka. Des effets immédiats ont parfois alimenté les ressentiments locaux des Algériens contre ces migrants qui servent de catalyseur au recrutement pour les groupes armés terroristes. Ces migrants non nigériens appelés «piétons» sont débarqués au «point zéro», dans la zone désertique qui délimite la frontière entre les deux pays. De là ils ont encore 15 kilomètres à parcourir à pied sous un chaud soleil pour atteindre Assamaka dans des conditions difficiles à expliquer. Une Ong locale a mis en garde contre une «catastrophe» humanitaire après que l'Algérie a refoulé 4975 migrants africains vers le Niger début avril. Des organisations non gouvernementales comme International Crisis Group, Human Rights Watch, Amnesty International et des think tanks spécialisés ont documenté sur la corrélation entre expansion géographique et diversification des acteurs armés au Sahel. D'autres données des agences humanitaires de l'ONU (HCR, PAM), des organisations comme Médecins Sans Frontières et des études sur les liens entre changement climatique, ressources et conflits sont disponibles pour mettre en évidence le risque d'escalade régionale. Ce qui s'explique par l’implication croissante de différents pays de la région (Algérie, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad etc.) dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires, parfois avec des agendas et des alliances divergentes, augmente le risque d'une escalade régionale involontaire ou intentionnelle. Les tensions diplomatiques entre certains pays sahéliens et leur voisin algérien ou certains partenaires au sein de la CEDEAO contribuent également à ce risque. Sans oublier les déclarations politiques, les projets de déploiements militaires et les analyses des relations diplomatiques sur les pays de la région.
L'argument le plus facile qui reste à l'Algérie à exhiber joker, c'est de semer les germes d'une probabilité immédiate de guerre éclair tout en reconnaissant le seuil de risque élevé de conflits généralisés, au nom de la compétition pour les ressources, entraînant des déplacements massifs de populations, l'insécurité alimentaire, le changement climatique et les difficultés liées à l'accès à l'eau et aux terres cultivables. Des crises humanitaires qui exacerbent les tensions intercommunautaires et peuvent être instrumentalisées par les groupes armés contrôlés par Alger pour le recrutement et la division.
Évaluer intelligemment le risque d'une telle guerre au Sahel nécessite une analyse complexe et nuancée, intégrant de multiples facteurs interconnectés qui s'appuient sur des données vérifiables et des logiques argumentatives pour offrir une évaluation éclairée, bien qu'il soit impossible de prédire l'avenir avec certitude. Cependant, le terme de "guerre totale", impliquant un conflit ouvert et généralisé entre des blocs d'États ou de forces majeures à l'échelle de tout le Sahel, n'est pas encore une fatalité immédiate. Même si la situation est extrêmement volatile et pourrait basculer rapidement en fonction d'événements déclencheurs (escalade militaire majeure, effondrement étatique dans un pays clé, intervention externe mal maîtrisée). Une prévention efficace nécessiterait une approche multidimensionnelle intégrale.
KML
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
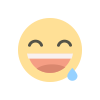 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0







































