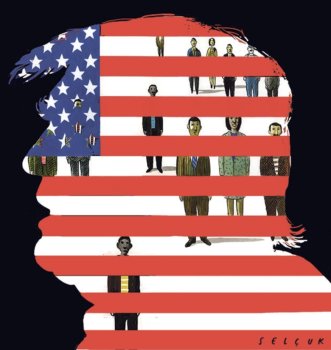La France nomme un représentant spécial pour le Sahel
[caption id="attachment_75411" align="alignleft" width="300" caption="Jean Felix-Paganon a été nommé par le ministre des Affaires étrangères « représentant spécial pour le Sahel ». Photo : France diplomatie"] [/caption]
Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a désigné le 25 juin l'ambassadeur Jean Felix-Paganon comme son « représentant spécial pour le Sahel » avec la mission de lui proposer « un plan d'action ».
Ex-ambassadeur en Égypte, « Jean Felix-Paganon est à Bamako (ce lundi) où il remettra un message du ministre (...) au Premier ministre de transition malien Cheikh Modibo Diarra », a précisé Bernard Valero, porte-parole du Quai d'Orsay. « Il se rendra, également, dans les prochains jours dans plusieurs autres pays de la région », a-t-il ajouté, sans préciser lesquels.
À l'issue de ces contacts, l’ambassadeur aura pour mission de présenter « un plan d'action pour le Sahel ». Depuis plusieurs mois la France tente de mobiliser ses partenaires sur la question de la sécurité alimentaire et de la sécurité physique au Sahel.
Au Mali, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra a pris le dossier en main, le président de la Transition, Dioncounda Traoré étant toujours à Paris pour des soins et des examens médicaux suite à son agression physique dans ses bureaux, à Koulouba, le 21 mai. Le Premier ministre a initié une concertation avec certains pays. Il s’est rendu en Algérie (le 12 & 13 juin) avant de rejoindre Nouakchott le 16 juin, après un bref séjour à Paris où il avait rencontré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et la conseillère Afrique à l’Élysée, Mme Hélène Le Gal. Le Premier ministre malien poursuit ses concertations. Il était le 22 et le 23 juin à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur de la Cedeao dans la crise malienne.
(Avec AFP)/ 25/06/2012 à 17:51
[/caption]
Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a désigné le 25 juin l'ambassadeur Jean Felix-Paganon comme son « représentant spécial pour le Sahel » avec la mission de lui proposer « un plan d'action ».
Ex-ambassadeur en Égypte, « Jean Felix-Paganon est à Bamako (ce lundi) où il remettra un message du ministre (...) au Premier ministre de transition malien Cheikh Modibo Diarra », a précisé Bernard Valero, porte-parole du Quai d'Orsay. « Il se rendra, également, dans les prochains jours dans plusieurs autres pays de la région », a-t-il ajouté, sans préciser lesquels.
À l'issue de ces contacts, l’ambassadeur aura pour mission de présenter « un plan d'action pour le Sahel ». Depuis plusieurs mois la France tente de mobiliser ses partenaires sur la question de la sécurité alimentaire et de la sécurité physique au Sahel.
Au Mali, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra a pris le dossier en main, le président de la Transition, Dioncounda Traoré étant toujours à Paris pour des soins et des examens médicaux suite à son agression physique dans ses bureaux, à Koulouba, le 21 mai. Le Premier ministre a initié une concertation avec certains pays. Il s’est rendu en Algérie (le 12 & 13 juin) avant de rejoindre Nouakchott le 16 juin, après un bref séjour à Paris où il avait rencontré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et la conseillère Afrique à l’Élysée, Mme Hélène Le Gal. Le Premier ministre malien poursuit ses concertations. Il était le 22 et le 23 juin à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur de la Cedeao dans la crise malienne.
(Avec AFP)/ 25/06/2012 à 17:51
 [/caption]
Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a désigné le 25 juin l'ambassadeur Jean Felix-Paganon comme son « représentant spécial pour le Sahel » avec la mission de lui proposer « un plan d'action ».
Ex-ambassadeur en Égypte, « Jean Felix-Paganon est à Bamako (ce lundi) où il remettra un message du ministre (...) au Premier ministre de transition malien Cheikh Modibo Diarra », a précisé Bernard Valero, porte-parole du Quai d'Orsay. « Il se rendra, également, dans les prochains jours dans plusieurs autres pays de la région », a-t-il ajouté, sans préciser lesquels.
À l'issue de ces contacts, l’ambassadeur aura pour mission de présenter « un plan d'action pour le Sahel ». Depuis plusieurs mois la France tente de mobiliser ses partenaires sur la question de la sécurité alimentaire et de la sécurité physique au Sahel.
Au Mali, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra a pris le dossier en main, le président de la Transition, Dioncounda Traoré étant toujours à Paris pour des soins et des examens médicaux suite à son agression physique dans ses bureaux, à Koulouba, le 21 mai. Le Premier ministre a initié une concertation avec certains pays. Il s’est rendu en Algérie (le 12 & 13 juin) avant de rejoindre Nouakchott le 16 juin, après un bref séjour à Paris où il avait rencontré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et la conseillère Afrique à l’Élysée, Mme Hélène Le Gal. Le Premier ministre malien poursuit ses concertations. Il était le 22 et le 23 juin à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur de la Cedeao dans la crise malienne.
(Avec AFP)/ 25/06/2012 à 17:51
[/caption]
Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a désigné le 25 juin l'ambassadeur Jean Felix-Paganon comme son « représentant spécial pour le Sahel » avec la mission de lui proposer « un plan d'action ».
Ex-ambassadeur en Égypte, « Jean Felix-Paganon est à Bamako (ce lundi) où il remettra un message du ministre (...) au Premier ministre de transition malien Cheikh Modibo Diarra », a précisé Bernard Valero, porte-parole du Quai d'Orsay. « Il se rendra, également, dans les prochains jours dans plusieurs autres pays de la région », a-t-il ajouté, sans préciser lesquels.
À l'issue de ces contacts, l’ambassadeur aura pour mission de présenter « un plan d'action pour le Sahel ». Depuis plusieurs mois la France tente de mobiliser ses partenaires sur la question de la sécurité alimentaire et de la sécurité physique au Sahel.
Au Mali, le Premier ministre Cheick Modibo Diarra a pris le dossier en main, le président de la Transition, Dioncounda Traoré étant toujours à Paris pour des soins et des examens médicaux suite à son agression physique dans ses bureaux, à Koulouba, le 21 mai. Le Premier ministre a initié une concertation avec certains pays. Il s’est rendu en Algérie (le 12 & 13 juin) avant de rejoindre Nouakchott le 16 juin, après un bref séjour à Paris où il avait rencontré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et la conseillère Afrique à l’Élysée, Mme Hélène Le Gal. Le Premier ministre malien poursuit ses concertations. Il était le 22 et le 23 juin à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur de la Cedeao dans la crise malienne.
(Avec AFP)/ 25/06/2012 à 17:51 Mots clés:
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
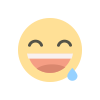 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0
Articles Similaires
-
 babaduhonOn a toujours dit que les noirs ne peuvent jamais resoudre leurs propres probleme,eh bien,c'est vrai,il faut que la france bouge sinon le mali restera comme ca pendant 10 ans. Quelle honte! Pour la race noire.13 ansRépondreLike (0)
babaduhonOn a toujours dit que les noirs ne peuvent jamais resoudre leurs propres probleme,eh bien,c'est vrai,il faut que la france bouge sinon le mali restera comme ca pendant 10 ans. Quelle honte! Pour la race noire.13 ansRépondreLike (0) -
 grraGéopolitique du Sahara, crise généralisée du capitalisme mondialisé, crises identitaires et avenir de l’Etat-nation : le cas du Mali 25 juin 2012 Rubrique: Contributions Commentaires fermés [-] Texte [+] Email Imprimer Partager 3 L’offensive foudroyante du Mlna au Nord du Mali saluée par le tonitruant Ministre français des affaires étrangères de Sarkozy et la proclamation de l’indépendance de l’Azawad sur le sol français ouvrirent brutalement les yeux à beaucoup de Maliennes et de Maliens sur les complicités françaises récurrentes à la crise que traversent les régions sahariennes en Afrique. Juppé n’en était pas à son premier essai. Alain Juppé Les tentatives de dépeçage des pays des Grands lacs et le génocide rwandais ne sont qu’une des nombreuses illustrations des coups tordus de la France durant plus d’un siècle de domination qu’elle continue à exercer en Afrique. La crise actuelle au Mali ne s’inscrit-elle pas dans la même logique ? L’historiographie coloniale française a toujours présenté les espaces conquis comme des territoires où des populations ‘barbares’ se livraient à des guerres tribales incessantes. Ils auraient été pacifiés par la colonisation française présentée jusqu’à une date récente comme une œuvre de civilisation. On passe volontiers sous silence la déstructuration brutale de ces sociétés, la perte de leur équilibre interne, le ferment de la division semé par les nouveaux maîtres consacrant ainsi le fameux principe du diviser pour régner. Dans l’imaginaire collectif ainsi créé, les touaregs ont souvent été présenté comme un peuple de guerriers détestant le travail manuel et vivant de razzias, ce qui leur permettait de vivre des bien produits par les populations avoisinantes. Ainsi sont sommairement expliquées les rebellions successives auxquelles ils se sont livrés. On se rappelle aussi toutes les constructions idylliques sur les ‘hommes bleus du désert’ et les dénonciations vigoureuses et répétées du prétendu génocide dont ils étaient l’objet de la part des Etats africains de la région. Bien sûr, de nombreux actes condamnables ont été posés dans la gestion de ces régions par les Etats africains nouvellement indépendants. Mais les touaregs n’en furent pas les seules victimes. Les populations du Sud, de l’Est comme de l’Ouest et les autres populations du Nord, toutes ethnies confondues, furent aussi des sacrifiées de la mal gouvernance étatique des décennies durant. Certaines régions de l’Ouest du Mali sont aujourd’hui plus mal loties à tous points de vue que celles du Nord sans compter les sommes colossales destinées au Nord détournées par une grande part, par les mêmes ressortissants du Nord, touaregs pour la plupart et plus précisément par certaines personnes qui ont eu à porter auparavant des armes contre leur pays. Les conflits armés successifs dans la région ont fait la fortune de bien de petits seigneurs de guerre, le fusil étant devenu le gagne pain le plus sûr dans ces contrées traversées par les différentes crises mondiales et les convoitises géopolitiques et économiques orchestrées depuis les pays du Nord. Le projet français de création de l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS) bien avant les indépendances en est un témoignage éloquent. De nombreux analystes ont souvent présenté les différentes rebellions touarègues comme étant l’expression d’une crise identitaire, le résultat de conflits ethniques récurrents dans l’espace saharien. Mais au lieu d’en être la cause, n’en seraient-elles pas plutôt l’une des conséquences? Peut-on réellement parler d’identité touarègue spécifique construite tout au long de l’histoire du Mali ? A-t-elle servi de base à la construction d’un Etat touarègue quelque part dans l’espace concerné ? L’histoire n’en fait nulle part mention et l’Azawad auquel fait allusion le Mlna ne fait qu’à peine 380 km2 autour de Tombouctou sur plus de 850.000 km2 occupés aujourd’hui. Le Mlna lui-même n’est qu’une fraction ultra minoritaire des touaregs qu’il prétend représenter. Par contre l’histoire du Mali a vu dans les mêmes espaces et au delà se croiser, se chevaucher et s’interpénétrer des royaumes et empires qui ont brassé entre elles des entités multi ethniques. Peut-on parler de nos jours d’identité songhaï, d’identité peuhle, d’identité bamanan, d’identité Sarakollé, d’identité sénoufo, bozo, dogon, etc ? Existe-t-il aujourd’hui un seul endroit déterminé où ne vivrait qu’une seule ethnie ? Dans le moindre village ont toujours existé plusieurs ethnies tout au long de l’histoire. Les grands empires qui ont couvert l’espace géographique malien et au-delà, ont permis bien avant la colonisation, le brassage multi ethnique des populations. L’espace sahélo-saharien en serait-il l’exception? Si dans certains pays voisins comme la Côte d’Ivoire et de manière générale dans certains pays de l’Afrique centrale, les conflits ethniques sont restés récurrents, les crises identitaires qui ont conduit à des guerres civiles parfois13 ansRépondreLike (0)
grraGéopolitique du Sahara, crise généralisée du capitalisme mondialisé, crises identitaires et avenir de l’Etat-nation : le cas du Mali 25 juin 2012 Rubrique: Contributions Commentaires fermés [-] Texte [+] Email Imprimer Partager 3 L’offensive foudroyante du Mlna au Nord du Mali saluée par le tonitruant Ministre français des affaires étrangères de Sarkozy et la proclamation de l’indépendance de l’Azawad sur le sol français ouvrirent brutalement les yeux à beaucoup de Maliennes et de Maliens sur les complicités françaises récurrentes à la crise que traversent les régions sahariennes en Afrique. Juppé n’en était pas à son premier essai. Alain Juppé Les tentatives de dépeçage des pays des Grands lacs et le génocide rwandais ne sont qu’une des nombreuses illustrations des coups tordus de la France durant plus d’un siècle de domination qu’elle continue à exercer en Afrique. La crise actuelle au Mali ne s’inscrit-elle pas dans la même logique ? L’historiographie coloniale française a toujours présenté les espaces conquis comme des territoires où des populations ‘barbares’ se livraient à des guerres tribales incessantes. Ils auraient été pacifiés par la colonisation française présentée jusqu’à une date récente comme une œuvre de civilisation. On passe volontiers sous silence la déstructuration brutale de ces sociétés, la perte de leur équilibre interne, le ferment de la division semé par les nouveaux maîtres consacrant ainsi le fameux principe du diviser pour régner. Dans l’imaginaire collectif ainsi créé, les touaregs ont souvent été présenté comme un peuple de guerriers détestant le travail manuel et vivant de razzias, ce qui leur permettait de vivre des bien produits par les populations avoisinantes. Ainsi sont sommairement expliquées les rebellions successives auxquelles ils se sont livrés. On se rappelle aussi toutes les constructions idylliques sur les ‘hommes bleus du désert’ et les dénonciations vigoureuses et répétées du prétendu génocide dont ils étaient l’objet de la part des Etats africains de la région. Bien sûr, de nombreux actes condamnables ont été posés dans la gestion de ces régions par les Etats africains nouvellement indépendants. Mais les touaregs n’en furent pas les seules victimes. Les populations du Sud, de l’Est comme de l’Ouest et les autres populations du Nord, toutes ethnies confondues, furent aussi des sacrifiées de la mal gouvernance étatique des décennies durant. Certaines régions de l’Ouest du Mali sont aujourd’hui plus mal loties à tous points de vue que celles du Nord sans compter les sommes colossales destinées au Nord détournées par une grande part, par les mêmes ressortissants du Nord, touaregs pour la plupart et plus précisément par certaines personnes qui ont eu à porter auparavant des armes contre leur pays. Les conflits armés successifs dans la région ont fait la fortune de bien de petits seigneurs de guerre, le fusil étant devenu le gagne pain le plus sûr dans ces contrées traversées par les différentes crises mondiales et les convoitises géopolitiques et économiques orchestrées depuis les pays du Nord. Le projet français de création de l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS) bien avant les indépendances en est un témoignage éloquent. De nombreux analystes ont souvent présenté les différentes rebellions touarègues comme étant l’expression d’une crise identitaire, le résultat de conflits ethniques récurrents dans l’espace saharien. Mais au lieu d’en être la cause, n’en seraient-elles pas plutôt l’une des conséquences? Peut-on réellement parler d’identité touarègue spécifique construite tout au long de l’histoire du Mali ? A-t-elle servi de base à la construction d’un Etat touarègue quelque part dans l’espace concerné ? L’histoire n’en fait nulle part mention et l’Azawad auquel fait allusion le Mlna ne fait qu’à peine 380 km2 autour de Tombouctou sur plus de 850.000 km2 occupés aujourd’hui. Le Mlna lui-même n’est qu’une fraction ultra minoritaire des touaregs qu’il prétend représenter. Par contre l’histoire du Mali a vu dans les mêmes espaces et au delà se croiser, se chevaucher et s’interpénétrer des royaumes et empires qui ont brassé entre elles des entités multi ethniques. Peut-on parler de nos jours d’identité songhaï, d’identité peuhle, d’identité bamanan, d’identité Sarakollé, d’identité sénoufo, bozo, dogon, etc ? Existe-t-il aujourd’hui un seul endroit déterminé où ne vivrait qu’une seule ethnie ? Dans le moindre village ont toujours existé plusieurs ethnies tout au long de l’histoire. Les grands empires qui ont couvert l’espace géographique malien et au-delà, ont permis bien avant la colonisation, le brassage multi ethnique des populations. L’espace sahélo-saharien en serait-il l’exception? Si dans certains pays voisins comme la Côte d’Ivoire et de manière générale dans certains pays de l’Afrique centrale, les conflits ethniques sont restés récurrents, les crises identitaires qui ont conduit à des guerres civiles parfois13 ansRépondreLike (0) -
 Dogon-BambaraVision 2012 et Sandigo,selon les chiffres suivants de 2009-2010 - Les Forces Arme’es Algeriennes sont constitue’es de 147 000 personnes. Le budget annuel reserve’ a’ cette force etait de $5 300 000 000 (cinq milliards et 300 millions de dollars.) - Le Burkina Fasso depensait annuellement $110 000 000 (110 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 11 200 personnes. - LE MALI DEPENSAIT $174 000 000 (174 MILLIONS DE DOLLARS)POUR SES FORCES ARME’ES CONSTITUE’ES DE 7750 PERSONNES. - La Mauritanie depensait $115 000 000 (115 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 15 870 personnes. - Le Niger depensait $ 53 100 000 (53.1 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 5 300 personnes. Rien qu’en analysant les chiffres cite’s plus haut, on consatate que le budget annuel que l’Algerie reserve a’ ses forces arme’es, est plus de 5 fois le budget que tous les autres pays ensemble reservent a’ leurs forces arme’es respectives. Toutes les guerres coutent financierement et humainement. Il faut developper des alliances strategiques pour eviter les guerre et/ou minimiser leurs consequences. Le Mali n’opere pas dans un vide.Si la France, l’Algerie, la Mauritanie et bien d’autres pays conseillent au Mali de negocier, il serait sage de les ecouter car ces pays aussi sont concerne’s par ce qui se passe au Sahel/Sahara! Nous savons que l’Algerie a connu sa propre lutte contre le terrorisme. Plusieurs sources ont indique’ de possibles liens entre les services securitaires algeriens et AQMI. Nous savons egalement que l’Algerie a supporte’ les touareg au Mali et au Niger afin de contrer les influences de plus en plus croissantes de Khadafi dans la region Sahelo-Saharienne. On peut lutter efficacement contre les terroristes islamistes si les deux conditions suivantes existent: 1- On doit etre d’accord pour definir l’ennemi. 2- On doit etre d’accord sur les strategies a’ suivre. Nous savons que le probleme de definition se pose. Tout comme la strategie de lutte propose’e par l’Algerie n’est pas necessairement celle que les autres pays du Sahel veulent voir. Plusieurs sources concordantes indiquent que les services securitaires algeriens ont pu infiltrer certains milieux militaires…maliens. En d’autres termes, ces officiers maliens travaillent pour l’Algerie au detriment du Mali. Il semblerait qu’il y avait meme un tres important ministre malien qui travaillait pour l’Algerie. On a remplace’ plusieurs officiers maliens qui travaillaient au nord pour les raisons cite’es plus haut. L’option militaire ne peut que donner un resultat catastrophique. Les negociations sont meilleures pour des raisons suivantes que je repete depuis plusieurs mois: 1- Le Mali a besoin de toutes ses ressources pour creer des projets de developpement afin de lutter contre la pauvrete’ et le chomage. 2- Le Mali est un pays enclave’ avec des frontieres de plusieurs milliers de km. Il a besoin de la cooperation internatioanle pour securiser lesdites frontieres et lutter contre le terrorisme. 3- Negocier pour accorder une autonomie de gestion au nord ramenera la paix et permettra aux populations locales d’avoir une plus grande participation dans la gestion de leurs affaires. SOYONS PRUDENTS, PRAGMATIQUES, REALISTES ET SAGES!13 ansRépondreLike (0)
Dogon-BambaraVision 2012 et Sandigo,selon les chiffres suivants de 2009-2010 - Les Forces Arme’es Algeriennes sont constitue’es de 147 000 personnes. Le budget annuel reserve’ a’ cette force etait de $5 300 000 000 (cinq milliards et 300 millions de dollars.) - Le Burkina Fasso depensait annuellement $110 000 000 (110 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 11 200 personnes. - LE MALI DEPENSAIT $174 000 000 (174 MILLIONS DE DOLLARS)POUR SES FORCES ARME’ES CONSTITUE’ES DE 7750 PERSONNES. - La Mauritanie depensait $115 000 000 (115 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 15 870 personnes. - Le Niger depensait $ 53 100 000 (53.1 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 5 300 personnes. Rien qu’en analysant les chiffres cite’s plus haut, on consatate que le budget annuel que l’Algerie reserve a’ ses forces arme’es, est plus de 5 fois le budget que tous les autres pays ensemble reservent a’ leurs forces arme’es respectives. Toutes les guerres coutent financierement et humainement. Il faut developper des alliances strategiques pour eviter les guerre et/ou minimiser leurs consequences. Le Mali n’opere pas dans un vide.Si la France, l’Algerie, la Mauritanie et bien d’autres pays conseillent au Mali de negocier, il serait sage de les ecouter car ces pays aussi sont concerne’s par ce qui se passe au Sahel/Sahara! Nous savons que l’Algerie a connu sa propre lutte contre le terrorisme. Plusieurs sources ont indique’ de possibles liens entre les services securitaires algeriens et AQMI. Nous savons egalement que l’Algerie a supporte’ les touareg au Mali et au Niger afin de contrer les influences de plus en plus croissantes de Khadafi dans la region Sahelo-Saharienne. On peut lutter efficacement contre les terroristes islamistes si les deux conditions suivantes existent: 1- On doit etre d’accord pour definir l’ennemi. 2- On doit etre d’accord sur les strategies a’ suivre. Nous savons que le probleme de definition se pose. Tout comme la strategie de lutte propose’e par l’Algerie n’est pas necessairement celle que les autres pays du Sahel veulent voir. Plusieurs sources concordantes indiquent que les services securitaires algeriens ont pu infiltrer certains milieux militaires…maliens. En d’autres termes, ces officiers maliens travaillent pour l’Algerie au detriment du Mali. Il semblerait qu’il y avait meme un tres important ministre malien qui travaillait pour l’Algerie. On a remplace’ plusieurs officiers maliens qui travaillaient au nord pour les raisons cite’es plus haut. L’option militaire ne peut que donner un resultat catastrophique. Les negociations sont meilleures pour des raisons suivantes que je repete depuis plusieurs mois: 1- Le Mali a besoin de toutes ses ressources pour creer des projets de developpement afin de lutter contre la pauvrete’ et le chomage. 2- Le Mali est un pays enclave’ avec des frontieres de plusieurs milliers de km. Il a besoin de la cooperation internatioanle pour securiser lesdites frontieres et lutter contre le terrorisme. 3- Negocier pour accorder une autonomie de gestion au nord ramenera la paix et permettra aux populations locales d’avoir une plus grande participation dans la gestion de leurs affaires. SOYONS PRUDENTS, PRAGMATIQUES, REALISTES ET SAGES!13 ansRépondreLike (0) -
 maiga issaIl est le bienvenu et il doit savoir que seuls les avis du mali et de la cedeao doivent compter dans ses futures conclusions mais en aucun cas celui de l Algerie qui a choisi son camp.Le Mali doit savoir que l Algerie c est le pobleme tres loin d etre la solution13 ansRépondreLike (0)
maiga issaIl est le bienvenu et il doit savoir que seuls les avis du mali et de la cedeao doivent compter dans ses futures conclusions mais en aucun cas celui de l Algerie qui a choisi son camp.Le Mali doit savoir que l Algerie c est le pobleme tres loin d etre la solution13 ansRépondreLike (0)-
 Dogon-BambaraVision 2012 et Sandigo,selon les chiffres suivants de 2009-2010 - Les Forces Arme’es Algeriennes sont constitue’es de 147 000 personnes. Le budget annuel reserve’ a’ cette force etait de $5 300 000 000 (cinq milliards et 300 millions de dollars.) - Le Burkina Fasso depensait annuellement $110 000 000 (110 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 11 200 personnes. - LE MALI DEPENSAIT $174 000 000 (174 MILLIONS DE DOLLARS)POUR SES FORCES ARME’ES CONSTITUE’ES DE 7750 PERSONNES. - La Mauritanie depensait $115 000 000 (115 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 15 870 personnes. - Le Niger depensait $ 53 100 000 (53.1 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 5 300 personnes. Rien qu’en analysant les chiffres cite’s plus haut, on consatate que le budget annuel que l’Algerie reserve a’ ses forces arme’es, est plus de 5 fois le budget que tous les autres pays ensemble reservent a’ leurs forces arme’es respectives. Toutes les guerres coutent financierement et humainement. Il faut developper des alliances strategiques pour eviter les guerre et/ou minimiser leurs consequences. Le Mali n’opere pas dans un vide.Si la France, l’Algerie, la Mauritanie et bien d’autres pays conseillent au Mali de negocier, il serait sage de les ecouter car ces pays aussi sont concerne’s par ce qui se passe au Sahel/Sahara! Nous savons que l’Algerie a connu sa propre lutte contre le terrorisme. Plusieurs sources ont indique’ de possibles liens entre les services securitaires algeriens et AQMI. Nous savons egalement que l’Algerie a supporte’ les touareg au Mali et au Niger afin de contrer les influences de plus en plus croissantes de Khadafi dans la region Sahelo-Saharienne. On peut lutter efficacement contre les terroristes islamistes si les deux conditions suivantes existent: 1- On doit etre d’accord pour definir l’ennemi. 2- On doit etre d’accord sur les strategies a’ suivre. Nous savons que le probleme de definition se pose. Tout comme la strategie de lutte propose’e par l’Algerie n’est pas necessairement celle que les autres pays du Sahel veulent voir. Plusieurs sources concordantes indiquent que les services securitaires algeriens ont pu infiltrer certains milieux militaires…maliens. En d’autres termes, ces officiers maliens travaillent pour l’Algerie au detriment du Mali. Il semblerait qu’il y avait meme un tres important ministre malien qui travaillait pour l’Algerie. On a remplace’ plusieurs officiers maliens qui travaillaient au nord pour les raisons cite’es plus haut. L’option militaire ne peut que donner un resultat catastrophique. Les negociations sont meilleures pour des raisons suivantes que je repete depuis plusieurs mois: 1- Le Mali a besoin de toutes ses ressources pour creer des projets de developpement afin de lutter contre la pauvrete’ et le chomage. 2- Le Mali est un pays enclave’ avec des frontieres de plusieurs milliers de km. Il a besoin de la cooperation internatioanle pour securiser lesdites frontieres et lutter contre le terrorisme. 3- Negocier pour accorder une autonomie de gestion au nord ramenera la paix et permettra aux populations locales d’avoir une plus grande participation dans la gestion de leurs affaires. SOYONS PRUDENTS, PRAGMATIQUES, REALISTES ET SAGES!13 ansLike (0)
Dogon-BambaraVision 2012 et Sandigo,selon les chiffres suivants de 2009-2010 - Les Forces Arme’es Algeriennes sont constitue’es de 147 000 personnes. Le budget annuel reserve’ a’ cette force etait de $5 300 000 000 (cinq milliards et 300 millions de dollars.) - Le Burkina Fasso depensait annuellement $110 000 000 (110 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 11 200 personnes. - LE MALI DEPENSAIT $174 000 000 (174 MILLIONS DE DOLLARS)POUR SES FORCES ARME’ES CONSTITUE’ES DE 7750 PERSONNES. - La Mauritanie depensait $115 000 000 (115 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 15 870 personnes. - Le Niger depensait $ 53 100 000 (53.1 millions de dollars) pour ses Forces Arme’es constitue’es de 5 300 personnes. Rien qu’en analysant les chiffres cite’s plus haut, on consatate que le budget annuel que l’Algerie reserve a’ ses forces arme’es, est plus de 5 fois le budget que tous les autres pays ensemble reservent a’ leurs forces arme’es respectives. Toutes les guerres coutent financierement et humainement. Il faut developper des alliances strategiques pour eviter les guerre et/ou minimiser leurs consequences. Le Mali n’opere pas dans un vide.Si la France, l’Algerie, la Mauritanie et bien d’autres pays conseillent au Mali de negocier, il serait sage de les ecouter car ces pays aussi sont concerne’s par ce qui se passe au Sahel/Sahara! Nous savons que l’Algerie a connu sa propre lutte contre le terrorisme. Plusieurs sources ont indique’ de possibles liens entre les services securitaires algeriens et AQMI. Nous savons egalement que l’Algerie a supporte’ les touareg au Mali et au Niger afin de contrer les influences de plus en plus croissantes de Khadafi dans la region Sahelo-Saharienne. On peut lutter efficacement contre les terroristes islamistes si les deux conditions suivantes existent: 1- On doit etre d’accord pour definir l’ennemi. 2- On doit etre d’accord sur les strategies a’ suivre. Nous savons que le probleme de definition se pose. Tout comme la strategie de lutte propose’e par l’Algerie n’est pas necessairement celle que les autres pays du Sahel veulent voir. Plusieurs sources concordantes indiquent que les services securitaires algeriens ont pu infiltrer certains milieux militaires…maliens. En d’autres termes, ces officiers maliens travaillent pour l’Algerie au detriment du Mali. Il semblerait qu’il y avait meme un tres important ministre malien qui travaillait pour l’Algerie. On a remplace’ plusieurs officiers maliens qui travaillaient au nord pour les raisons cite’es plus haut. L’option militaire ne peut que donner un resultat catastrophique. Les negociations sont meilleures pour des raisons suivantes que je repete depuis plusieurs mois: 1- Le Mali a besoin de toutes ses ressources pour creer des projets de developpement afin de lutter contre la pauvrete’ et le chomage. 2- Le Mali est un pays enclave’ avec des frontieres de plusieurs milliers de km. Il a besoin de la cooperation internatioanle pour securiser lesdites frontieres et lutter contre le terrorisme. 3- Negocier pour accorder une autonomie de gestion au nord ramenera la paix et permettra aux populations locales d’avoir une plus grande participation dans la gestion de leurs affaires. SOYONS PRUDENTS, PRAGMATIQUES, REALISTES ET SAGES!13 ansLike (0)
-









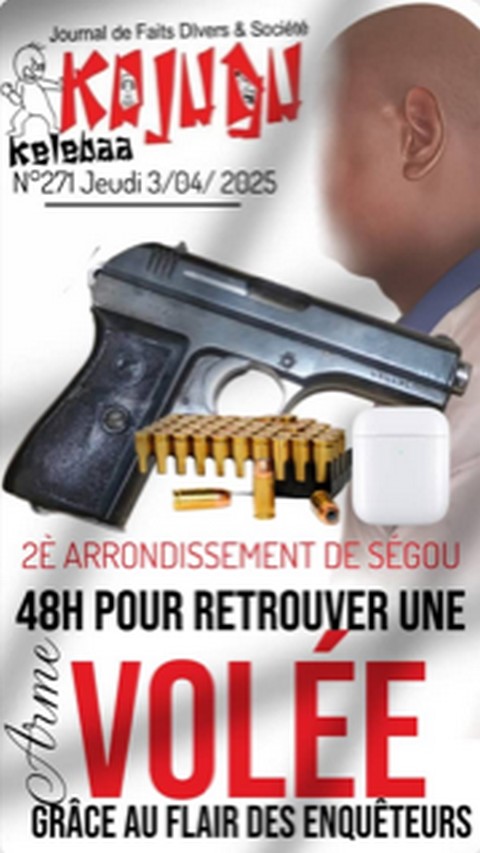









![[Tchad] Évasion massive à Mongo : plus de 130 prisonniers prennent la fuite !](https://www.maliweb.net/wp-content/news/images/2025/04/prison-niger-1.avif)