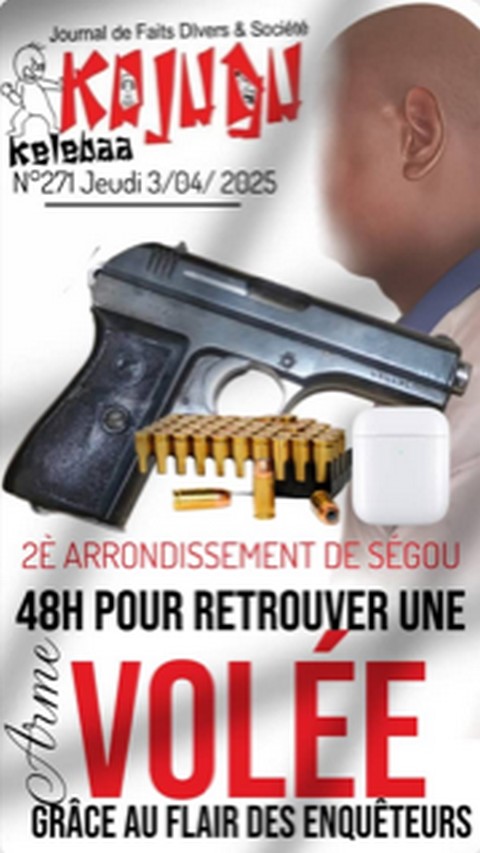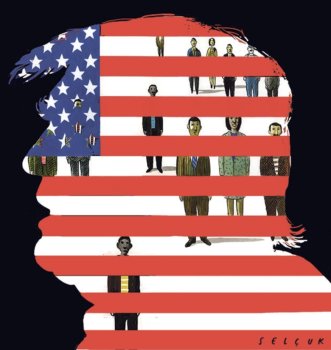Retour des soldats libyens a Kidal-présence d’AQMI-trafics: Un cadre touareg parle
 Pour accepter de nous accorder cette interview, ce cadre touareg a posé cette condition : ne pas dévoiler son identité. Condition posée parce qu’il a sa famille dans une localité du nord du pays. Condition posée pour assurer sa propre sécurité et celle de ses parents qui sont au nord du pays. Condition enfin posée, parce qu’il s’apprête à prendre fonction dans une structure qui réduit sa liberté d’expression. Après acceptation de cette condition, nous avons décidé (avec son accord) de ne livrer que les initiales de notre interviewé, AAM.
L’Aube : Depuis quelques jours, la situation au nord est dominée par le retour des soldats libyens d’origine malienne. En tant qu’observateur et ressortissant du nord, comment percevez-vous l’arrivée de ces compatriotes de la Libye ?
AAM : En tant que Malien, j’ai tout d’abord pensé que ce sont des Maliens qui vivaient en Libye, qui ont eu des problèmes avec ce qui s’est passé là et qui ont regagné le pays. Mais au fil des jours, j’ai compris que ce sont effectivement des soldats d’origine malienne plus des Libyens, qui sont venus avec un arsenal militaire depuis la Libye. En tant que ressortissant du nord, je perçois ça comme plusieurs pas en arrière pour les régions nord du Mali. Je perçois ce retour comme un recul réel par rapport à tout ce qui se passe dans le nord. Je le perçois comme une menace réelle à la tranquillité des populations du nord. A mon avis, ce retour doit être traité avec intelligence, surtout qu’il n’y a pas que des Maliens.
En quoi ce retour constitue-t-il une menace à la tranquillité des populations du nord ?
C’est une menace parce que ce ne sont pas des individus ordinaires, ce sont des militaires qui ne sont pas forcément imbus de la culture malienne, qui n’ont pas forcément une connaissance des relations complexes mais très positives qui existent entre les différentes populations du Mali. C’est une menace parce qu’il y a parmi tous ces groupes qui arrivent, des gens qui ignorent beaucoup de choses du Mali ; que le Mali est une nation au vrai sens du terme.
Parmi les revenants, certains sont arrivés avec un esprit de paix et se disent disposés à respecter les lois de la République. Ces engagements sont-ils rassurants ?
Là, je réponds en tant que connaisseurs des tribus et des populations du nord et même technicien de la région. Je crois que ces engagements doivent être pris avec beaucoup de précautions. Je ne dis pas qu’il n’y a pas parmi eux des individus acquis à la cause nationale et au respect des lois dela République, mais on ne devrait pas nous laisser tromper par des allégeances qui n’ont pas encore été analysées. Je préfère émettre une réserve réelle par rapport à ces disponibilités. Ce que je sais par ailleurs, c’est que ces revenants sont composés de presque toutes les tribus qui existent au nord. Même en milieu nomades, des tribus existent qui ne sont pas belliqueuses bien qu’elles aient la possibilité de l’être, qui sont toujours restées aux côtés de l’Etat, qui ont toujours appuyé l’Etat dans ses initiatives. Mais la situation actuelle qui prévaut fait qu’on ne peut pas affirmer que ce constat de toujours va être pérenne. Il y a des nouvelles donnes à prendre en compte notamment le discours tenu par les arrivants, leurs intentions, l’intoxication des populations du nord. Parmi les nouvelles donnes, il faut souligner que ce sont des gens qui ont suivi de près ce qu’il est convenu d’appeler « Le printemps arabe ». Ils ont été sérieusement influencés par ce qui s’est passé dans les pays arabes. Ce sont naturellement des choses qu’on peut calquer au septentrion malien. C’est pourquoi, il faut prendre toutes les assurances données avec réserve. Il faut considérer ces assurances comme de simples déclarations de bonnes intentions.
Concrètement, quelle est aujourd’hui la situation à Kidal, Gao et Tombouctou ?
La situation est tellement compliquée que personne n’est à mesure de vous la décrire de façon statique. D’abord, en milieu touareg, les hommes changent, les idées évoluent, tout comme a changé et a évolué la chefferie depuis les temps immémoriaux au gré de la razzia. C’est un milieu nomade où il n’y a pas de choses figées. J’ai lu dans votre parution du 3 novembre 2011, qu’il y a des scissions, que dans l’ensemble ces populations ont des intentions belliqueuses, même s’il y en a qui n’en ont pas. Je sais qu’à Tombouctou, à Gao comme à Kidal, il y a des arrivants civils ou pas. Je sais par ailleurs qu’il y a des gens qui sensibilisent les populations pour une position non belliqueuse. Je sais maintenant qu’à l’intérieur des tribus trouvées sur place, je me garderai de me prononcer sur ces tribus, mais je sais que la mienne a une position traditionnelle, proche de l’Etat.
Je pense qu’aucun pays au monde mieux que le Mali ne s’apprête pour faire l’épanouissement des Touaregs ; aucun pays au monde mieux que le Mali n’est prêt pour faire l’émancipation des Touaregs ; aucun pays au monde mieux que le Mali n’est prêt pour l’intégration des Touaregs ; aucun pays au monde mieux que le Mali n’est prêt à accorder autant d’avantages que le Mali en accorde aux populations du nord en général, et singulièrement aux populations nomades, tant au sein des différents gouvernements qu’au plan de la promotion dans l’armée. Ici, on a des officiers supérieurs « analphabètes ». Ce sont là des sacrifices énormes consentis par l’Etat. A mon avis, en tant que citoyen malien du nord, je pense que le reste devrait venir à travers le développement. Le nord est autant décentralisé et s’auto administre comme les autres régions du Mali. C’est la menace d’insécurité permanente du nord qui fait que le reste n’est pas venu. Ce n’est pas la faute des pouvoirs publics. Il faut aussi reconnaître que le président dela République, Amadou Toumani Touré, est le président le plus disponible, le plus pacifique ; celui qui a privilégié le dialogue, qui n’a jamais décliné la démarche civile, qui a fait la promotion de la société civile, et qui a donné toutes les chances de règlement de la crise, du développement des régions nord, de l’intégration à travers le dialogue ; ainsi que toutes les chances de toutes les promotions à tous les niveaux des échelons de l’Etat à travers cette démarche.
Je pense que la situation qui prévaut au nord actuellement mérite qu’on recentre cette démarche prônée par le président dela République, qui a éloigné de lui tous les « Satans », toutes les velléités. Il faudra agir en ne se trompant surtout pas de négociateurs ou d’interlocuteurs ; mais comme le disent certains, Dieu a toujours été du côté du Mali.
En dépit de tout ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui explique cette volonté belliqueuse de certains revenants ?
Les explications sont d’ordre interne et externe. Les revenants ne sont pas tous animés d’intentions belliqueuses, mais il faut chercher les explications dans des facteurs endogènes et exogènes au Mali, différentes tribus nomades, au niveau des intellectuels, au niveau de ceux-là qui sont dans d’interminables règlements de compte. Il ne faut pas ignorer non plus que d’autres ficelles sont tirées depuis l’extérieur. Voilà l’explication modeste que je donne à cette situation.
Il semble que sur le terrain, il y a actuellement des personnes de bonne volonté qui ont entamé des négociations, sur l’initiative du gouvernement, pour ramener tous les revenants à se mettre à la disposition de l’Etat. Est-ce que selon vous ces missions de bons offices ont des chances d’aboutir ?
Je ne peux donner une réponse exacte à cette question. D’abord, je ne suis pas au courant de missions de bons offices envoyées par le gouvernement. Par contre, je sais qu’il y a des notables et d’autres bonnes volontés qui ont approché les arrivants de Libye, tant les hommes armés que les populations civiles, pour comprendre et non pour négocier. Ils viennent pour écouter et non pour discuter et le plus souvent pour des questions de curiosité. Quelques rares fois des débats s’instaurent. Pour qu’il y ait aboutissement, il faut qu’il y ait négociation, et à ce que je sache, il n’y a pas de négociation. Les causeries-débats d’information, de compréhension, de curiosité, de reconnaissance qui se déroulent sont butées à toutes les réponses, positives, négatives, intermédiaires. Une organisation type de négociation n’existe pas. Nous sommes en présence de groupes tribaux dont le rapprochement se fait par affinité ou par voisinage ou par reconnaissance ou par complaisance. Ces groupes tribaux ont des approches, des visions, des appréciations et des réponses différentes. Mais, la globale qui se dégage et à laquelle les uns et les autres doivent se cramponner, c’est que nous sommes en présence d’hommes armés qui constituent une menace à la stabilité du Mali. Et je pense que c’est à ça qu’il faut s’en tenir et envisager des solutions.
Est-ce qu’ils ont des exigences ?
La rumeur fait état d’exigences sécessionnistes et indépendantistes. Je me suis posé la question de savoir « Indépendance par rapport à quoi et à qui ? ». J’avoue que personnellement, je n’ai pas compris ce langage parce que c’est de la rumeur.
Mais, à propos, il y a eu une marche à Kidal et une autre à Ménaka. Est-ce une simple coïncidence ?
Je n’ai pas été témoin de ces marches là. Ce que j’en sais c’est que ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes, des femmes qui reçoivent des leçons de famille du MLA (Mouvement de libération de l’Azawad) qui marchent. Ce sont des marches de provocation qui ne sont pas organisées par des individus connus, reconnus ou affichés.
En tant qu’observateur et citoyen ordinaire, est-ce que vous avez des propositions à l’adresse de l’Etat pour résoudre cette situation actuelle dans la région de Kidal ?
L’Etat devrait faire attention aux premiers venus qui se font passer pour des démarcheurs et à tous ceux qui font croire aux autorités que c’est une affaire globale ou générale. L’Etat devrait éviter que des responsables, élus ou pas, émettent des commentaires qui sont de nature à faire croire que c’est un éventuel soulèvement. Il faut que l’Etat adopte une responsabilisation au niveau de chaque tribu ; responsabiliser les cadres, les élus, les notables, les chefs de fraction de chaque tribu. Dès lors, même s’il devrait y avoir malheur ce serait la moitié du malheur. Il y a des populations qui sont prêtes à assumer ce genre de responsabilité.
Dans un deuxième temps, je propose à l’Etat de privilégier, comme d’habitude, cette démarche démocratique de règlement des conflits.
Puis, en troisième et dernier lieu, je propose que l’Etat rejette systématiquement toutes velléités sécessionnistes et autres qui ne disent pas leur nom et que, pour une fois, l’Etat ne se trompe pas dans l’implication et par rapport aux discours et aux intentions des voisins qu’ils soient Nigériens, Mauritaniens, Algériens.
Ces dernières années, le septentrion malien a une image de zone d’insécurité avec la présence d’Aqmi, de trafiquants de drogues, de groupes armés. Qu’est-ce qui explique cette image sombre collée au nord du Mali ?
L’explication est simple : le vide a été créé au nord. Il y a eu un allègement assez lourd du dispositif sécuritaire à la suite de la signature du Pacte national. Avec la décentralisation, l’administration a pris un autre chemin. Au nord, on est en présence d’un no man’s land très vaste dans lequel vous pouvez circuler dans tout un cercle sans rencontrer un agent de sécurité. La formule classique dit que la nature a horreur du vide ; d’autres sont venus l’occuper en proposant leurs services aux populations. On y trouve le passage de la drogue, des armes, des cigarettes ; on y trouve des distributeurs de dattes. Finalement, tout est parti. Mais, je crois que le problème a été accentué à la suite de la victoire du FIS en Algérie et tout ce qui s’est passé après cela.
Un dernier élément qui me semble important, c’est le laisser-aller, c’est la fluidité des frontières. Cela a permis un brassage des populations très mobiles parmi lesquelles il y a ces trafiquants, les désœuvrés. Et l’oisiveté des jeunes a constitué l’engrais sur lequel a germé tout ça. Particulièrement, l’année 2010 a été une année très sèche, pire que les sécheresses de 1973 et 1984-1985. Cela a poussé des jeunes restés jusque là tranquilles à tirer leur survie de tous ces mouvements. Et nous sommes en présence d’Aqmi et d’autres groupes armés dans le nord, et même de gens qui cherchent simplement à vivre par la force des armes.
Selon les analystes, la crise libyenne et surtout la disparition de Kadhafi risquent de basculer encore plus la région sahélienne dans une instabilité. Qu’en pensez-vous ?
J’ai effectivement constaté que ces rébellions récurrentes dans notre pays coïncident toujours avec la fin de quelque chose. Dans les années 1960, c’est le départ de l’administration coloniale française; dans les années 1990, c’est la fin de la guerre du Tchad. Actuellement, s’il y a une rébellion, ça peut coïncider avec la fin de Kadhafi alors.
En tant que ressortissant du nord, j’avoue que la disparition de Kadhafi est une fin qui ne peut que nuire au Mali. Parce que le régime de Kadhafi a recruté beaucoup de Maliens dans les forces de sécurité libyennes, il a gardé beaucoup de populations du Mali dans toutes les régions dela Libye. Laplupart de ces populations, civiles et militaires, étant revenues, je puis vous affirmer qu’on est dans un risque majeur de rébellion au nord du Mali. Ceux qui sont revenus n’ont même pas de rudiments de connaissance sur les imbrications de la société et de la nation maliennes. Ces revenants n’ont pas de connaissance sur la volonté réelle du président ATT de faire la promotion des Maliens, de développer le Mali, de resserrer les liens entre les différentes populations maliennes. Parmi eux, beaucoup ignorent l’emblème national, les armoiries de l’Etat. Si ces populations savaient l’engagement et le dévouement du président dela République, elles auraient choisi de vivre paisiblement aux côtés de ceux-là qu’ils sont venus trouver.
Je ne saurais terminer sans préciser que les Touaregs sont en majorité des éleveurs, donc en majorité étrangers à cette situation. Même si une rébellion éclatait, elle sera imposée à certaines populations touarègues et presque même à l’ensemble ; elle sera l’initiative de certains individus. Moi qui suis touareg et qui ai eu la chance de connaître le Mali, je peux avouer que les problèmes qui attendent le sud du Mali dépassent ceux qui attendent le nord du Mali, tant au niveau des populations qu’au niveau du développement.
Si ces revenants pouvaient comprendre que le Mali a consenti des sacrifices énormes pour le nord et qu’il est prêt à faire encore beaucoup plus, ils écouteraient tous ces notables qui viennent à eux. L’Etat doit consentir des efforts pour comprendre les motivations réelles des revenants et les motivations d’éventuels manipulateurs. Et en tirer les leçons nécessaires.
Pour accepter de nous accorder cette interview, ce cadre touareg a posé cette condition : ne pas dévoiler son identité. Condition posée parce qu’il a sa famille dans une localité du nord du pays. Condition posée pour assurer sa propre sécurité et celle de ses parents qui sont au nord du pays. Condition enfin posée, parce qu’il s’apprête à prendre fonction dans une structure qui réduit sa liberté d’expression. Après acceptation de cette condition, nous avons décidé (avec son accord) de ne livrer que les initiales de notre interviewé, AAM.
L’Aube : Depuis quelques jours, la situation au nord est dominée par le retour des soldats libyens d’origine malienne. En tant qu’observateur et ressortissant du nord, comment percevez-vous l’arrivée de ces compatriotes de la Libye ?
AAM : En tant que Malien, j’ai tout d’abord pensé que ce sont des Maliens qui vivaient en Libye, qui ont eu des problèmes avec ce qui s’est passé là et qui ont regagné le pays. Mais au fil des jours, j’ai compris que ce sont effectivement des soldats d’origine malienne plus des Libyens, qui sont venus avec un arsenal militaire depuis la Libye. En tant que ressortissant du nord, je perçois ça comme plusieurs pas en arrière pour les régions nord du Mali. Je perçois ce retour comme un recul réel par rapport à tout ce qui se passe dans le nord. Je le perçois comme une menace réelle à la tranquillité des populations du nord. A mon avis, ce retour doit être traité avec intelligence, surtout qu’il n’y a pas que des Maliens.
En quoi ce retour constitue-t-il une menace à la tranquillité des populations du nord ?
C’est une menace parce que ce ne sont pas des individus ordinaires, ce sont des militaires qui ne sont pas forcément imbus de la culture malienne, qui n’ont pas forcément une connaissance des relations complexes mais très positives qui existent entre les différentes populations du Mali. C’est une menace parce qu’il y a parmi tous ces groupes qui arrivent, des gens qui ignorent beaucoup de choses du Mali ; que le Mali est une nation au vrai sens du terme.
Parmi les revenants, certains sont arrivés avec un esprit de paix et se disent disposés à respecter les lois de la République. Ces engagements sont-ils rassurants ?
Là, je réponds en tant que connaisseurs des tribus et des populations du nord et même technicien de la région. Je crois que ces engagements doivent être pris avec beaucoup de précautions. Je ne dis pas qu’il n’y a pas parmi eux des individus acquis à la cause nationale et au respect des lois dela République, mais on ne devrait pas nous laisser tromper par des allégeances qui n’ont pas encore été analysées. Je préfère émettre une réserve réelle par rapport à ces disponibilités. Ce que je sais par ailleurs, c’est que ces revenants sont composés de presque toutes les tribus qui existent au nord. Même en milieu nomades, des tribus existent qui ne sont pas belliqueuses bien qu’elles aient la possibilité de l’être, qui sont toujours restées aux côtés de l’Etat, qui ont toujours appuyé l’Etat dans ses initiatives. Mais la situation actuelle qui prévaut fait qu’on ne peut pas affirmer que ce constat de toujours va être pérenne. Il y a des nouvelles donnes à prendre en compte notamment le discours tenu par les arrivants, leurs intentions, l’intoxication des populations du nord. Parmi les nouvelles donnes, il faut souligner que ce sont des gens qui ont suivi de près ce qu’il est convenu d’appeler « Le printemps arabe ». Ils ont été sérieusement influencés par ce qui s’est passé dans les pays arabes. Ce sont naturellement des choses qu’on peut calquer au septentrion malien. C’est pourquoi, il faut prendre toutes les assurances données avec réserve. Il faut considérer ces assurances comme de simples déclarations de bonnes intentions.
Concrètement, quelle est aujourd’hui la situation à Kidal, Gao et Tombouctou ?
La situation est tellement compliquée que personne n’est à mesure de vous la décrire de façon statique. D’abord, en milieu touareg, les hommes changent, les idées évoluent, tout comme a changé et a évolué la chefferie depuis les temps immémoriaux au gré de la razzia. C’est un milieu nomade où il n’y a pas de choses figées. J’ai lu dans votre parution du 3 novembre 2011, qu’il y a des scissions, que dans l’ensemble ces populations ont des intentions belliqueuses, même s’il y en a qui n’en ont pas. Je sais qu’à Tombouctou, à Gao comme à Kidal, il y a des arrivants civils ou pas. Je sais par ailleurs qu’il y a des gens qui sensibilisent les populations pour une position non belliqueuse. Je sais maintenant qu’à l’intérieur des tribus trouvées sur place, je me garderai de me prononcer sur ces tribus, mais je sais que la mienne a une position traditionnelle, proche de l’Etat.
Je pense qu’aucun pays au monde mieux que le Mali ne s’apprête pour faire l’épanouissement des Touaregs ; aucun pays au monde mieux que le Mali n’est prêt pour faire l’émancipation des Touaregs ; aucun pays au monde mieux que le Mali n’est prêt pour l’intégration des Touaregs ; aucun pays au monde mieux que le Mali n’est prêt à accorder autant d’avantages que le Mali en accorde aux populations du nord en général, et singulièrement aux populations nomades, tant au sein des différents gouvernements qu’au plan de la promotion dans l’armée. Ici, on a des officiers supérieurs « analphabètes ». Ce sont là des sacrifices énormes consentis par l’Etat. A mon avis, en tant que citoyen malien du nord, je pense que le reste devrait venir à travers le développement. Le nord est autant décentralisé et s’auto administre comme les autres régions du Mali. C’est la menace d’insécurité permanente du nord qui fait que le reste n’est pas venu. Ce n’est pas la faute des pouvoirs publics. Il faut aussi reconnaître que le président dela République, Amadou Toumani Touré, est le président le plus disponible, le plus pacifique ; celui qui a privilégié le dialogue, qui n’a jamais décliné la démarche civile, qui a fait la promotion de la société civile, et qui a donné toutes les chances de règlement de la crise, du développement des régions nord, de l’intégration à travers le dialogue ; ainsi que toutes les chances de toutes les promotions à tous les niveaux des échelons de l’Etat à travers cette démarche.
Je pense que la situation qui prévaut au nord actuellement mérite qu’on recentre cette démarche prônée par le président dela République, qui a éloigné de lui tous les « Satans », toutes les velléités. Il faudra agir en ne se trompant surtout pas de négociateurs ou d’interlocuteurs ; mais comme le disent certains, Dieu a toujours été du côté du Mali.
En dépit de tout ce que vous venez de dire, qu’est-ce qui explique cette volonté belliqueuse de certains revenants ?
Les explications sont d’ordre interne et externe. Les revenants ne sont pas tous animés d’intentions belliqueuses, mais il faut chercher les explications dans des facteurs endogènes et exogènes au Mali, différentes tribus nomades, au niveau des intellectuels, au niveau de ceux-là qui sont dans d’interminables règlements de compte. Il ne faut pas ignorer non plus que d’autres ficelles sont tirées depuis l’extérieur. Voilà l’explication modeste que je donne à cette situation.
Il semble que sur le terrain, il y a actuellement des personnes de bonne volonté qui ont entamé des négociations, sur l’initiative du gouvernement, pour ramener tous les revenants à se mettre à la disposition de l’Etat. Est-ce que selon vous ces missions de bons offices ont des chances d’aboutir ?
Je ne peux donner une réponse exacte à cette question. D’abord, je ne suis pas au courant de missions de bons offices envoyées par le gouvernement. Par contre, je sais qu’il y a des notables et d’autres bonnes volontés qui ont approché les arrivants de Libye, tant les hommes armés que les populations civiles, pour comprendre et non pour négocier. Ils viennent pour écouter et non pour discuter et le plus souvent pour des questions de curiosité. Quelques rares fois des débats s’instaurent. Pour qu’il y ait aboutissement, il faut qu’il y ait négociation, et à ce que je sache, il n’y a pas de négociation. Les causeries-débats d’information, de compréhension, de curiosité, de reconnaissance qui se déroulent sont butées à toutes les réponses, positives, négatives, intermédiaires. Une organisation type de négociation n’existe pas. Nous sommes en présence de groupes tribaux dont le rapprochement se fait par affinité ou par voisinage ou par reconnaissance ou par complaisance. Ces groupes tribaux ont des approches, des visions, des appréciations et des réponses différentes. Mais, la globale qui se dégage et à laquelle les uns et les autres doivent se cramponner, c’est que nous sommes en présence d’hommes armés qui constituent une menace à la stabilité du Mali. Et je pense que c’est à ça qu’il faut s’en tenir et envisager des solutions.
Est-ce qu’ils ont des exigences ?
La rumeur fait état d’exigences sécessionnistes et indépendantistes. Je me suis posé la question de savoir « Indépendance par rapport à quoi et à qui ? ». J’avoue que personnellement, je n’ai pas compris ce langage parce que c’est de la rumeur.
Mais, à propos, il y a eu une marche à Kidal et une autre à Ménaka. Est-ce une simple coïncidence ?
Je n’ai pas été témoin de ces marches là. Ce que j’en sais c’est que ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes, des femmes qui reçoivent des leçons de famille du MLA (Mouvement de libération de l’Azawad) qui marchent. Ce sont des marches de provocation qui ne sont pas organisées par des individus connus, reconnus ou affichés.
En tant qu’observateur et citoyen ordinaire, est-ce que vous avez des propositions à l’adresse de l’Etat pour résoudre cette situation actuelle dans la région de Kidal ?
L’Etat devrait faire attention aux premiers venus qui se font passer pour des démarcheurs et à tous ceux qui font croire aux autorités que c’est une affaire globale ou générale. L’Etat devrait éviter que des responsables, élus ou pas, émettent des commentaires qui sont de nature à faire croire que c’est un éventuel soulèvement. Il faut que l’Etat adopte une responsabilisation au niveau de chaque tribu ; responsabiliser les cadres, les élus, les notables, les chefs de fraction de chaque tribu. Dès lors, même s’il devrait y avoir malheur ce serait la moitié du malheur. Il y a des populations qui sont prêtes à assumer ce genre de responsabilité.
Dans un deuxième temps, je propose à l’Etat de privilégier, comme d’habitude, cette démarche démocratique de règlement des conflits.
Puis, en troisième et dernier lieu, je propose que l’Etat rejette systématiquement toutes velléités sécessionnistes et autres qui ne disent pas leur nom et que, pour une fois, l’Etat ne se trompe pas dans l’implication et par rapport aux discours et aux intentions des voisins qu’ils soient Nigériens, Mauritaniens, Algériens.
Ces dernières années, le septentrion malien a une image de zone d’insécurité avec la présence d’Aqmi, de trafiquants de drogues, de groupes armés. Qu’est-ce qui explique cette image sombre collée au nord du Mali ?
L’explication est simple : le vide a été créé au nord. Il y a eu un allègement assez lourd du dispositif sécuritaire à la suite de la signature du Pacte national. Avec la décentralisation, l’administration a pris un autre chemin. Au nord, on est en présence d’un no man’s land très vaste dans lequel vous pouvez circuler dans tout un cercle sans rencontrer un agent de sécurité. La formule classique dit que la nature a horreur du vide ; d’autres sont venus l’occuper en proposant leurs services aux populations. On y trouve le passage de la drogue, des armes, des cigarettes ; on y trouve des distributeurs de dattes. Finalement, tout est parti. Mais, je crois que le problème a été accentué à la suite de la victoire du FIS en Algérie et tout ce qui s’est passé après cela.
Un dernier élément qui me semble important, c’est le laisser-aller, c’est la fluidité des frontières. Cela a permis un brassage des populations très mobiles parmi lesquelles il y a ces trafiquants, les désœuvrés. Et l’oisiveté des jeunes a constitué l’engrais sur lequel a germé tout ça. Particulièrement, l’année 2010 a été une année très sèche, pire que les sécheresses de 1973 et 1984-1985. Cela a poussé des jeunes restés jusque là tranquilles à tirer leur survie de tous ces mouvements. Et nous sommes en présence d’Aqmi et d’autres groupes armés dans le nord, et même de gens qui cherchent simplement à vivre par la force des armes.
Selon les analystes, la crise libyenne et surtout la disparition de Kadhafi risquent de basculer encore plus la région sahélienne dans une instabilité. Qu’en pensez-vous ?
J’ai effectivement constaté que ces rébellions récurrentes dans notre pays coïncident toujours avec la fin de quelque chose. Dans les années 1960, c’est le départ de l’administration coloniale française; dans les années 1990, c’est la fin de la guerre du Tchad. Actuellement, s’il y a une rébellion, ça peut coïncider avec la fin de Kadhafi alors.
En tant que ressortissant du nord, j’avoue que la disparition de Kadhafi est une fin qui ne peut que nuire au Mali. Parce que le régime de Kadhafi a recruté beaucoup de Maliens dans les forces de sécurité libyennes, il a gardé beaucoup de populations du Mali dans toutes les régions dela Libye. Laplupart de ces populations, civiles et militaires, étant revenues, je puis vous affirmer qu’on est dans un risque majeur de rébellion au nord du Mali. Ceux qui sont revenus n’ont même pas de rudiments de connaissance sur les imbrications de la société et de la nation maliennes. Ces revenants n’ont pas de connaissance sur la volonté réelle du président ATT de faire la promotion des Maliens, de développer le Mali, de resserrer les liens entre les différentes populations maliennes. Parmi eux, beaucoup ignorent l’emblème national, les armoiries de l’Etat. Si ces populations savaient l’engagement et le dévouement du président dela République, elles auraient choisi de vivre paisiblement aux côtés de ceux-là qu’ils sont venus trouver.
Je ne saurais terminer sans préciser que les Touaregs sont en majorité des éleveurs, donc en majorité étrangers à cette situation. Même si une rébellion éclatait, elle sera imposée à certaines populations touarègues et presque même à l’ensemble ; elle sera l’initiative de certains individus. Moi qui suis touareg et qui ai eu la chance de connaître le Mali, je peux avouer que les problèmes qui attendent le sud du Mali dépassent ceux qui attendent le nord du Mali, tant au niveau des populations qu’au niveau du développement.
Si ces revenants pouvaient comprendre que le Mali a consenti des sacrifices énormes pour le nord et qu’il est prêt à faire encore beaucoup plus, ils écouteraient tous ces notables qui viennent à eux. L’Etat doit consentir des efforts pour comprendre les motivations réelles des revenants et les motivations d’éventuels manipulateurs. Et en tirer les leçons nécessaires.
Réalisée par CH Sylla
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
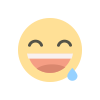 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0