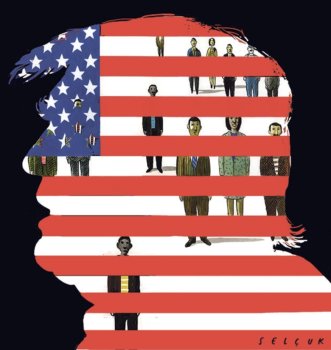Comme toutes les affaires humaines, l’art et le métier de penser ont leurs limites. On se demande justement si l’actualité malienne de la guerre déborde désormais les activités de penser et d’agir. Si plumes et pioches doivent désormais céder la place aux baïonnettes et aux communiqués des différents protagonistes, devons-nous, sous le prétexte de l’insignifiance des mots, nous taire face au poids tragique des événements ?
Comme toutes les affaires humaines, l’art et le métier de penser ont leurs limites. On se demande justement si l’actualité malienne de la guerre déborde désormais les activités de penser et d’agir. Si plumes et pioches doivent désormais céder la place aux baïonnettes et aux communiqués des différents protagonistes, devons-nous, sous le prétexte de l’insignifiance des mots, nous taire face au poids tragique des événements ?
Face aux corps sans vie des soldats égorgés au cours de cette guerre à Aguel’hoc, face à ces milliers de Maliens assommés par la terreur des terroristes MNLA et d’AQMI lancés dans le Nord contre le peuple malien, que les écrits à l’heure où l’actualité malienne ne s’interprète désormais qu’en terme de progression ou de régression militaires ? Maliens ou non, nous sommes condamnés à méditer cette énigme, surtout que notre métier n’est ni celui des armes, ni celui de la guerre, mais celui de penser. Mais la pensée peut-elle appréhender cette crise en cours? Peut-elle la comprendre et l’interpréter ? Est-elle plutôt condamnée à « contempler » ce mal tout en reconnaissant sa propre défaite ? Faut-il remettre la pensée du drame malien à l’après-élection d’avril 2012 ? Au-delà du bruit des « orgues de Staline » et autres armes lourdes de guerre qui tonnent dans les oreilles des citoyens, la pudeur ne recommande-t-elle pas de se taire face à l’ampleur du drame?
Or il y a précisément plusieurs types de guerre et de justifications aux actes de guerre. Condamner la guerre par principe et au nom d’un pacifisme aveugle est aussi naïf que de louer par principe les cas factuels la guerre au nom d’un bellicisme tout aussi stupide. Partant de ce principe, la philosophe Simone Veil a sans doute raison d’écrire : « Il résulte d’une telle situation, pour tout homme amoureux du bien public, un déchirement cruel et sans remède. Participer, même de loin, au jeu des forces qui meuvent l’histoire n’est guère possible sans se souiller ou sans se condamner d’avance à la défaite. Se réfugier dans l’indifférence ou dans une tour d’ivoire n’est guère possible non plus sans inconscience. La formule du moindre mal reste alors la seule applicable, mais à condition de l’appliquer avec la plus froide lucidité ».
Incontestablement, un devoir de lucidité nous interpelle. Par conséquent, nous estimons qu’il n’y a pas de pensée profonde qui n’ait justement médité face à l’abjection d’une mort violente Dès lors, il appartient, à ceux qui font office de penser la réalité historique malienne, de se prononcer clairement sur cette question : la guerre des forces armées maliennes contre les rebelles du MNLA est-elle une guerre juste ? Une question qui en entraîne une autre : quelles sont les formes et justifications de guerre connues dans l’historicité malienne ? Dans quel type de guerre peut-on classer l’offensive actuellement engagée par l’armée malienne contre les rebelles ceux du MNLA ?
Des guerres maliennes et d’ailleurs
Du 13è au 19è siècle, l’histoire du Mali semble avoir donné lieu à différentes sortes de guerres : les batailles de Kirina et de Sikasso, les guerres de conquête religieuse, de conquête coloniale, de résistance anticoloniale, d’indépendance, de résistance sécessionniste, de reconnaissance citoyenne... Nous n’oublions pourtant pas qu’il en existe d’autres à travers le monde. Mais il peut exister des points pertinents entre ces catégories de guerre et l’expérience malienne. La guerre suppose l’avènement d’un conflit entre deux forces plus ou moins égales. Lorsque ces forces sont inégales, les terminologues de la guerre parlent de pacification ou d’opération de police (fort contre faible), de rébellion ou de révolution (faible contre fort). On peut en outre classifier les guerres selon des critères politiques (conflit supra ou super-étatiques, phénomènes interétatiques ou conflits classiques, conflits intra-étatiques), selon des critères liés aux enjeux (territorial, ethnique, religieux), selon des critères techniques (guerres primaire, classique, technologique, atomique...), selon la localisation, la finalité ou les causes, etc. Le concept de guerre est du reste en extension permanente car les formes modernes de guerre ne cessent de s’enrichir suivant la nature et la dimension des groupes concernés, suivant le rapport politique et suivant les techniques mises en œuvre.
On compte ainsi, parmi les formes modernes de guerre, les guerres économique, commerciale, linguistique, culturelle, les guerres mondiales ou guerres totales, les guerres régionales, les guerres électronique, étrangère, psychologique, aristocratique, la guerre totale ou guerre de masse, la guérilla...Enfin, aux guerres, on reconnaît en général plusieurs fonctions et causes. Parmi les fonctions, on cite le rééquilibrage démographico-économique, la redistribution économique, la prise des commandes du politique, la conquête psychologique et sociologique d’un groupe de la population sur les autres, la domination culturelle, l’expérimentation de nouvelles techniques coercitives, la fonction biologique d’exutoire à l’agressivité foncière de l’homme.
Quant aux causes des guerres, elles sont généralement concernées par la volonté de multiplier les entités politiques, les conflits liés à l’hétérogénéité du système international, les institutions abusives de frontières interétatiques, le développement incontrôlé de certaines passions collectives. Ce large tour d’horizon nous permet donc d’en revenir aux guerres maliennes et à leurs justifications. Nous les classerons à trois ensembles correspondant aux périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale.
A suivre…
Paul N’guessan
 Comme toutes les affaires humaines, l’art et le métier de penser ont leurs limites. On se demande justement si l’actualité malienne de la guerre déborde désormais les activités de penser et d’agir. Si plumes et pioches doivent désormais céder la place aux baïonnettes et aux communiqués des différents protagonistes, devons-nous, sous le prétexte de l’insignifiance des mots, nous taire face au poids tragique des événements ?
Face aux corps sans vie des soldats égorgés au cours de cette guerre à Aguel’hoc, face à ces milliers de Maliens assommés par la terreur des terroristes MNLA et d’AQMI lancés dans le Nord contre le peuple malien, que les écrits à l’heure où l’actualité malienne ne s’interprète désormais qu’en terme de progression ou de régression militaires ? Maliens ou non, nous sommes condamnés à méditer cette énigme, surtout que notre métier n’est ni celui des armes, ni celui de la guerre, mais celui de penser. Mais la pensée peut-elle appréhender cette crise en cours? Peut-elle la comprendre et l’interpréter ? Est-elle plutôt condamnée à « contempler » ce mal tout en reconnaissant sa propre défaite ? Faut-il remettre la pensée du drame malien à l’après-élection d’avril 2012 ? Au-delà du bruit des « orgues de Staline » et autres armes lourdes de guerre qui tonnent dans les oreilles des citoyens, la pudeur ne recommande-t-elle pas de se taire face à l’ampleur du drame?
Or il y a précisément plusieurs types de guerre et de justifications aux actes de guerre. Condamner la guerre par principe et au nom d’un pacifisme aveugle est aussi naïf que de louer par principe les cas factuels la guerre au nom d’un bellicisme tout aussi stupide. Partant de ce principe, la philosophe Simone Veil a sans doute raison d’écrire : « Il résulte d’une telle situation, pour tout homme amoureux du bien public, un déchirement cruel et sans remède. Participer, même de loin, au jeu des forces qui meuvent l’histoire n’est guère possible sans se souiller ou sans se condamner d’avance à la défaite. Se réfugier dans l’indifférence ou dans une tour d’ivoire n’est guère possible non plus sans inconscience. La formule du moindre mal reste alors la seule applicable, mais à condition de l’appliquer avec la plus froide lucidité ».
Incontestablement, un devoir de lucidité nous interpelle. Par conséquent, nous estimons qu’il n’y a pas de pensée profonde qui n’ait justement médité face à l’abjection d’une mort violente Dès lors, il appartient, à ceux qui font office de penser la réalité historique malienne, de se prononcer clairement sur cette question : la guerre des forces armées maliennes contre les rebelles du MNLA est-elle une guerre juste ? Une question qui en entraîne une autre : quelles sont les formes et justifications de guerre connues dans l’historicité malienne ? Dans quel type de guerre peut-on classer l’offensive actuellement engagée par l’armée malienne contre les rebelles ceux du MNLA ?
Des guerres maliennes et d’ailleurs
Du 13è au 19è siècle, l’histoire du Mali semble avoir donné lieu à différentes sortes de guerres : les batailles de Kirina et de Sikasso, les guerres de conquête religieuse, de conquête coloniale, de résistance anticoloniale, d’indépendance, de résistance sécessionniste, de reconnaissance citoyenne... Nous n’oublions pourtant pas qu’il en existe d’autres à travers le monde. Mais il peut exister des points pertinents entre ces catégories de guerre et l’expérience malienne. La guerre suppose l’avènement d’un conflit entre deux forces plus ou moins égales. Lorsque ces forces sont inégales, les terminologues de la guerre parlent de pacification ou d’opération de police (fort contre faible), de rébellion ou de révolution (faible contre fort). On peut en outre classifier les guerres selon des critères politiques (conflit supra ou super-étatiques, phénomènes interétatiques ou conflits classiques, conflits intra-étatiques), selon des critères liés aux enjeux (territorial, ethnique, religieux), selon des critères techniques (guerres primaire, classique, technologique, atomique...), selon la localisation, la finalité ou les causes, etc. Le concept de guerre est du reste en extension permanente car les formes modernes de guerre ne cessent de s’enrichir suivant la nature et la dimension des groupes concernés, suivant le rapport politique et suivant les techniques mises en œuvre.
On compte ainsi, parmi les formes modernes de guerre, les guerres économique, commerciale, linguistique, culturelle, les guerres mondiales ou guerres totales, les guerres régionales, les guerres électronique, étrangère, psychologique, aristocratique, la guerre totale ou guerre de masse, la guérilla...Enfin, aux guerres, on reconnaît en général plusieurs fonctions et causes. Parmi les fonctions, on cite le rééquilibrage démographico-économique, la redistribution économique, la prise des commandes du politique, la conquête psychologique et sociologique d’un groupe de la population sur les autres, la domination culturelle, l’expérimentation de nouvelles techniques coercitives, la fonction biologique d’exutoire à l’agressivité foncière de l’homme.
Quant aux causes des guerres, elles sont généralement concernées par la volonté de multiplier les entités politiques, les conflits liés à l’hétérogénéité du système international, les institutions abusives de frontières interétatiques, le développement incontrôlé de certaines passions collectives. Ce large tour d’horizon nous permet donc d’en revenir aux guerres maliennes et à leurs justifications. Nous les classerons à trois ensembles correspondant aux périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale.
A suivre…
Paul N’guessan
Comme toutes les affaires humaines, l’art et le métier de penser ont leurs limites. On se demande justement si l’actualité malienne de la guerre déborde désormais les activités de penser et d’agir. Si plumes et pioches doivent désormais céder la place aux baïonnettes et aux communiqués des différents protagonistes, devons-nous, sous le prétexte de l’insignifiance des mots, nous taire face au poids tragique des événements ?
Face aux corps sans vie des soldats égorgés au cours de cette guerre à Aguel’hoc, face à ces milliers de Maliens assommés par la terreur des terroristes MNLA et d’AQMI lancés dans le Nord contre le peuple malien, que les écrits à l’heure où l’actualité malienne ne s’interprète désormais qu’en terme de progression ou de régression militaires ? Maliens ou non, nous sommes condamnés à méditer cette énigme, surtout que notre métier n’est ni celui des armes, ni celui de la guerre, mais celui de penser. Mais la pensée peut-elle appréhender cette crise en cours? Peut-elle la comprendre et l’interpréter ? Est-elle plutôt condamnée à « contempler » ce mal tout en reconnaissant sa propre défaite ? Faut-il remettre la pensée du drame malien à l’après-élection d’avril 2012 ? Au-delà du bruit des « orgues de Staline » et autres armes lourdes de guerre qui tonnent dans les oreilles des citoyens, la pudeur ne recommande-t-elle pas de se taire face à l’ampleur du drame?
Or il y a précisément plusieurs types de guerre et de justifications aux actes de guerre. Condamner la guerre par principe et au nom d’un pacifisme aveugle est aussi naïf que de louer par principe les cas factuels la guerre au nom d’un bellicisme tout aussi stupide. Partant de ce principe, la philosophe Simone Veil a sans doute raison d’écrire : « Il résulte d’une telle situation, pour tout homme amoureux du bien public, un déchirement cruel et sans remède. Participer, même de loin, au jeu des forces qui meuvent l’histoire n’est guère possible sans se souiller ou sans se condamner d’avance à la défaite. Se réfugier dans l’indifférence ou dans une tour d’ivoire n’est guère possible non plus sans inconscience. La formule du moindre mal reste alors la seule applicable, mais à condition de l’appliquer avec la plus froide lucidité ».
Incontestablement, un devoir de lucidité nous interpelle. Par conséquent, nous estimons qu’il n’y a pas de pensée profonde qui n’ait justement médité face à l’abjection d’une mort violente Dès lors, il appartient, à ceux qui font office de penser la réalité historique malienne, de se prononcer clairement sur cette question : la guerre des forces armées maliennes contre les rebelles du MNLA est-elle une guerre juste ? Une question qui en entraîne une autre : quelles sont les formes et justifications de guerre connues dans l’historicité malienne ? Dans quel type de guerre peut-on classer l’offensive actuellement engagée par l’armée malienne contre les rebelles ceux du MNLA ?
Des guerres maliennes et d’ailleurs
Du 13è au 19è siècle, l’histoire du Mali semble avoir donné lieu à différentes sortes de guerres : les batailles de Kirina et de Sikasso, les guerres de conquête religieuse, de conquête coloniale, de résistance anticoloniale, d’indépendance, de résistance sécessionniste, de reconnaissance citoyenne... Nous n’oublions pourtant pas qu’il en existe d’autres à travers le monde. Mais il peut exister des points pertinents entre ces catégories de guerre et l’expérience malienne. La guerre suppose l’avènement d’un conflit entre deux forces plus ou moins égales. Lorsque ces forces sont inégales, les terminologues de la guerre parlent de pacification ou d’opération de police (fort contre faible), de rébellion ou de révolution (faible contre fort). On peut en outre classifier les guerres selon des critères politiques (conflit supra ou super-étatiques, phénomènes interétatiques ou conflits classiques, conflits intra-étatiques), selon des critères liés aux enjeux (territorial, ethnique, religieux), selon des critères techniques (guerres primaire, classique, technologique, atomique...), selon la localisation, la finalité ou les causes, etc. Le concept de guerre est du reste en extension permanente car les formes modernes de guerre ne cessent de s’enrichir suivant la nature et la dimension des groupes concernés, suivant le rapport politique et suivant les techniques mises en œuvre.
On compte ainsi, parmi les formes modernes de guerre, les guerres économique, commerciale, linguistique, culturelle, les guerres mondiales ou guerres totales, les guerres régionales, les guerres électronique, étrangère, psychologique, aristocratique, la guerre totale ou guerre de masse, la guérilla...Enfin, aux guerres, on reconnaît en général plusieurs fonctions et causes. Parmi les fonctions, on cite le rééquilibrage démographico-économique, la redistribution économique, la prise des commandes du politique, la conquête psychologique et sociologique d’un groupe de la population sur les autres, la domination culturelle, l’expérimentation de nouvelles techniques coercitives, la fonction biologique d’exutoire à l’agressivité foncière de l’homme.
Quant aux causes des guerres, elles sont généralement concernées par la volonté de multiplier les entités politiques, les conflits liés à l’hétérogénéité du système international, les institutions abusives de frontières interétatiques, le développement incontrôlé de certaines passions collectives. Ce large tour d’horizon nous permet donc d’en revenir aux guerres maliennes et à leurs justifications. Nous les classerons à trois ensembles correspondant aux périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale.
A suivre…
Paul N’guessan  Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
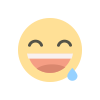 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0









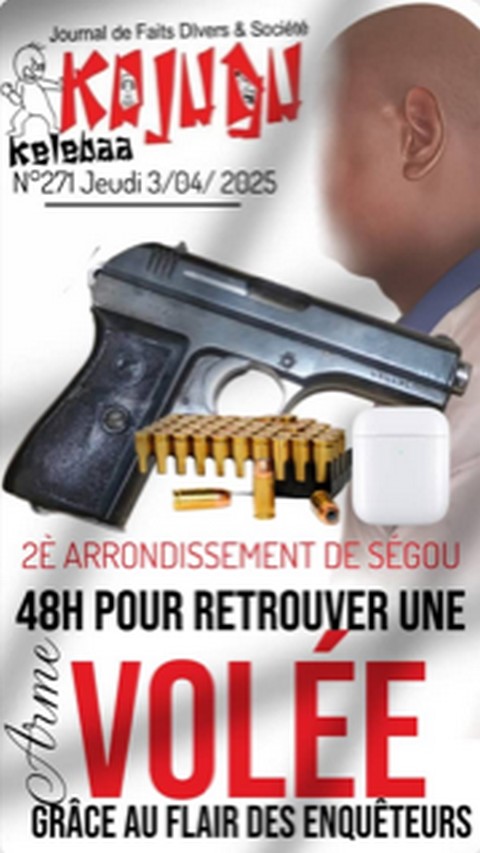









![[Tchad] Évasion massive à Mongo : plus de 130 prisonniers prennent la fuite !](https://www.maliweb.net/wp-content/news/images/2025/04/prison-niger-1.avif)