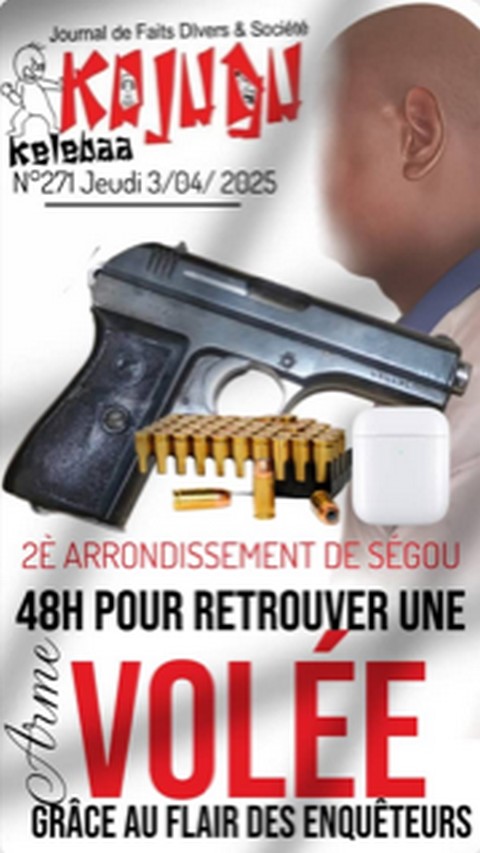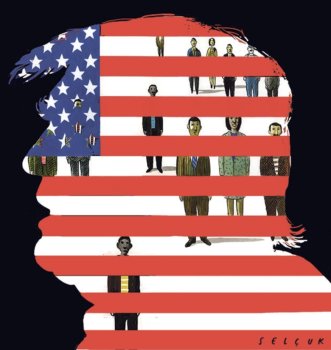[caption id="attachment_977932" align="alignleft" width="236"]

Abdourahamane Ben Mamata TOURE[/caption]
Le décrochage brutal du pouvoir survenu au Burkina fait l’objet d’analyses diverses dans les grins ainsi que la presse. Toutes les questions sont sur la table. Et les réponses apportées ne sont pas dénuées d`arrière pensées. Elles nous informent d`abord sur la position politique des uns et des autres à l`égard du Burkina et de son parcours politique. Un premier groupe d`analystes entend mettre en avant une exception Burkinabé heureuse- Une théorie du balai, exclusive de certains burkinabés au nom de la sainte volonté du peuple. Pêle-mêle sont avancés des arguments inquisitoires contre les souteneurs de la tentative de modification de l’article 37 de la constitution, la dissolution du régiment Présidentiel soupçonnée de brutalités épiphénoménales etc. Tout y passe ou presque .Tous ces éléments ont bien entendu leur poids dans une analyse honnête, mais ils ont le fâcheux défaut de mobiliser sur le plan scientifique une méthode peu pertinente : la méthode Coué. L`incantation valant démonstration, on souhaite faire correspondre la réalité, forcement complexe et insaisissable, aux désirs punitifs des vainqueurs du jour.
Le deuxième groupe d`analystes qui se distingue est celui de ceux qui n’ont rien compris depuis toujours. Ce sont les néo-obscurantistes, ceux qui voient tout en noir, et qui pensent que l’Afrique est damnée .Ils voient dans cette accélération de l`histoire une aubaine qui va enfin justifier leurs prédictions les plus ténébreuses et le grand déluge qu`ils nous ont toujours promis. Ils souhaitent très fort, que l`histoire leur donne raison. Cela est fort sympathique comme démarche, mais là, aussi, l`incantation remplace la démonstration et la méthode utilisée est aussi puérile. Que reste-il alors ?
Il reste ceux qui pensent que les choses sont suffisamment graves et dictent aux autorités de la transition de ce pays de se ressaisir et rester dans les limites strictes de cette période d’exception. Une transition par essence éphémère n’a pas vocation à se lancer dans des questions de réformes contrairement aux prétentions du Conseil national de réconciliation et des réformes.
L’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d’un pays institue des impossibilités d’accéder à des fonctions électives à l’encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce droit d’accès à des charges publiques doit alors être justifiée, notamment, par la commission d’infractions particulièrement graves. Il ne s’agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso aient, en principe, le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite qui est contraire aux textes. Interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait mais n’ayant commis aucune infraction établie, revient à instituer une sorte de délit d’opinion qui est évidemment inacceptable.
Il convient donc de donner au droit de restreindre l’accès à la compétition électorale sa portée exacte. Un tel droit ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des minorités politiques.
A cet égard, l’argument tiré de l’illégalité des changements anti constitutionnels de gouvernement ne tient pas. Si donc le principe de l’autonomie constitutionnelle et politique des Etats implique sans conteste que ceux-ci aient la latitude de déterminer le régime et les institutions politiques de leur choix, et d’adopter les lois qu’ils veulent, cette liberté doit être exercée en conformité avec les engagements que ces Etats ont souscrits en la matière. Dans le cadre particulier de la CEDEAO, on se contentera de renvoyer aux dispositions suivantes du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, conclu en 2001 :
– Article 1er g) :
« L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination (…) » ;
– Article 1er i) :
« Les partis politiques (…) participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie » ;
L’exclusion de pro-compaoré n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique, contrairement aux allégations des autorités de la transition. La restriction opérée par le Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher ces derniers de se porter candidats, elle limite également de façon importante le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de l’élection.
Dans son Observation générale 25, adoptée au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies déclare :
« L’application effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui, à tous égards seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires. Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat » (publié le 27 août 1996).
Souhaiter formellement une réconciliation nationale en posant des actes contraires aux engagements est contraire à la démocratie et à la volonté du peuple qui s’est soulevé contre une tentative de tripatouillage juridique. Où sont passés ces intello de la société civile, ces éminents constitutionnalistes qui passaient au peigne fin les défaillances juridiques et les enjeux des textes qu’adoptait le pouvoir Compaoré? La question mérite bien d’être posée parce que depuis la chute du pouvoir Compaoré, ces leaders de la société civile que l’opinion connait pour leur intransigeance et leur engagement pour le respect de la légalité se sont confondus dans une omerta inquiétante. Leurs réactions sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné l’Etat Burkinabé à lever tous les obstacles à la participation aux élections de tous les fils du pays sont aussi rares que les larmes d’un crocodile. Il y a aussi cette sorte de connivence de groupe qui, sans doute, oblige certains à garder le silence ou à fermer les yeux sur des dérives sidérantes. Le discours que tenaient ces connaisseurs du droit est en train de prendre, sinon a pris des allures de partialité. Une partialité qui les a certainement aveuglés au point que le nouveau Code électoral a laissé entrevoir des failles que «les forts d’hier», qui s’estiment brimés aujourd’hui, ont saisi comme un fouet pour «frapper» l’Etat burkinabè devant la cour de la CEDEAO.
Rien ne peux justifier un coup d’Etat cependant, il importe d’analyser cette tragédie dans la perspective d’une réflexion de fond sur les raisons endogènes des coups de force en Afrique ainsi que de nos rapports avec les normes et la capacité de nos dirigeants furent –ils de la transition à diriger en tenant le cap d’un objectif social pas souvent compris par le peuple mais qui dessine l’architecture de notre organisation sociale et politique future. Un Etat de droit, c’est un Etat qui se soumet au droit. Gardons nous de faire l’économie d’une réflexion substantielle en applaudissant là où on doit s’interroger et penser.
Abdourahamane TOURE  Abdourahamane Ben Mamata TOURE[/caption]
Le décrochage brutal du pouvoir survenu au Burkina fait l’objet d’analyses diverses dans les grins ainsi que la presse. Toutes les questions sont sur la table. Et les réponses apportées ne sont pas dénuées d`arrière pensées. Elles nous informent d`abord sur la position politique des uns et des autres à l`égard du Burkina et de son parcours politique. Un premier groupe d`analystes entend mettre en avant une exception Burkinabé heureuse- Une théorie du balai, exclusive de certains burkinabés au nom de la sainte volonté du peuple. Pêle-mêle sont avancés des arguments inquisitoires contre les souteneurs de la tentative de modification de l’article 37 de la constitution, la dissolution du régiment Présidentiel soupçonnée de brutalités épiphénoménales etc. Tout y passe ou presque .Tous ces éléments ont bien entendu leur poids dans une analyse honnête, mais ils ont le fâcheux défaut de mobiliser sur le plan scientifique une méthode peu pertinente : la méthode Coué. L`incantation valant démonstration, on souhaite faire correspondre la réalité, forcement complexe et insaisissable, aux désirs punitifs des vainqueurs du jour.
Le deuxième groupe d`analystes qui se distingue est celui de ceux qui n’ont rien compris depuis toujours. Ce sont les néo-obscurantistes, ceux qui voient tout en noir, et qui pensent que l’Afrique est damnée .Ils voient dans cette accélération de l`histoire une aubaine qui va enfin justifier leurs prédictions les plus ténébreuses et le grand déluge qu`ils nous ont toujours promis. Ils souhaitent très fort, que l`histoire leur donne raison. Cela est fort sympathique comme démarche, mais là, aussi, l`incantation remplace la démonstration et la méthode utilisée est aussi puérile. Que reste-il alors ?
Il reste ceux qui pensent que les choses sont suffisamment graves et dictent aux autorités de la transition de ce pays de se ressaisir et rester dans les limites strictes de cette période d’exception. Une transition par essence éphémère n’a pas vocation à se lancer dans des questions de réformes contrairement aux prétentions du Conseil national de réconciliation et des réformes.
L’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d’un pays institue des impossibilités d’accéder à des fonctions électives à l’encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce droit d’accès à des charges publiques doit alors être justifiée, notamment, par la commission d’infractions particulièrement graves. Il ne s’agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso aient, en principe, le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite qui est contraire aux textes. Interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait mais n’ayant commis aucune infraction établie, revient à instituer une sorte de délit d’opinion qui est évidemment inacceptable.
Il convient donc de donner au droit de restreindre l’accès à la compétition électorale sa portée exacte. Un tel droit ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des minorités politiques.
A cet égard, l’argument tiré de l’illégalité des changements anti constitutionnels de gouvernement ne tient pas. Si donc le principe de l’autonomie constitutionnelle et politique des Etats implique sans conteste que ceux-ci aient la latitude de déterminer le régime et les institutions politiques de leur choix, et d’adopter les lois qu’ils veulent, cette liberté doit être exercée en conformité avec les engagements que ces Etats ont souscrits en la matière. Dans le cadre particulier de la CEDEAO, on se contentera de renvoyer aux dispositions suivantes du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, conclu en 2001 :
– Article 1er g) : « L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination (…) » ;
– Article 1er i) : « Les partis politiques (…) participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie » ;
L’exclusion de pro-compaoré n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique, contrairement aux allégations des autorités de la transition. La restriction opérée par le Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher ces derniers de se porter candidats, elle limite également de façon importante le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de l’élection.
Dans son Observation générale 25, adoptée au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies déclare : « L’application effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui, à tous égards seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires. Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat » (publié le 27 août 1996).
Souhaiter formellement une réconciliation nationale en posant des actes contraires aux engagements est contraire à la démocratie et à la volonté du peuple qui s’est soulevé contre une tentative de tripatouillage juridique. Où sont passés ces intello de la société civile, ces éminents constitutionnalistes qui passaient au peigne fin les défaillances juridiques et les enjeux des textes qu’adoptait le pouvoir Compaoré? La question mérite bien d’être posée parce que depuis la chute du pouvoir Compaoré, ces leaders de la société civile que l’opinion connait pour leur intransigeance et leur engagement pour le respect de la légalité se sont confondus dans une omerta inquiétante. Leurs réactions sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné l’Etat Burkinabé à lever tous les obstacles à la participation aux élections de tous les fils du pays sont aussi rares que les larmes d’un crocodile. Il y a aussi cette sorte de connivence de groupe qui, sans doute, oblige certains à garder le silence ou à fermer les yeux sur des dérives sidérantes. Le discours que tenaient ces connaisseurs du droit est en train de prendre, sinon a pris des allures de partialité. Une partialité qui les a certainement aveuglés au point que le nouveau Code électoral a laissé entrevoir des failles que «les forts d’hier», qui s’estiment brimés aujourd’hui, ont saisi comme un fouet pour «frapper» l’Etat burkinabè devant la cour de la CEDEAO.
Rien ne peux justifier un coup d’Etat cependant, il importe d’analyser cette tragédie dans la perspective d’une réflexion de fond sur les raisons endogènes des coups de force en Afrique ainsi que de nos rapports avec les normes et la capacité de nos dirigeants furent –ils de la transition à diriger en tenant le cap d’un objectif social pas souvent compris par le peuple mais qui dessine l’architecture de notre organisation sociale et politique future. Un Etat de droit, c’est un Etat qui se soumet au droit. Gardons nous de faire l’économie d’une réflexion substantielle en applaudissant là où on doit s’interroger et penser.
Abdourahamane TOURE
Abdourahamane Ben Mamata TOURE[/caption]
Le décrochage brutal du pouvoir survenu au Burkina fait l’objet d’analyses diverses dans les grins ainsi que la presse. Toutes les questions sont sur la table. Et les réponses apportées ne sont pas dénuées d`arrière pensées. Elles nous informent d`abord sur la position politique des uns et des autres à l`égard du Burkina et de son parcours politique. Un premier groupe d`analystes entend mettre en avant une exception Burkinabé heureuse- Une théorie du balai, exclusive de certains burkinabés au nom de la sainte volonté du peuple. Pêle-mêle sont avancés des arguments inquisitoires contre les souteneurs de la tentative de modification de l’article 37 de la constitution, la dissolution du régiment Présidentiel soupçonnée de brutalités épiphénoménales etc. Tout y passe ou presque .Tous ces éléments ont bien entendu leur poids dans une analyse honnête, mais ils ont le fâcheux défaut de mobiliser sur le plan scientifique une méthode peu pertinente : la méthode Coué. L`incantation valant démonstration, on souhaite faire correspondre la réalité, forcement complexe et insaisissable, aux désirs punitifs des vainqueurs du jour.
Le deuxième groupe d`analystes qui se distingue est celui de ceux qui n’ont rien compris depuis toujours. Ce sont les néo-obscurantistes, ceux qui voient tout en noir, et qui pensent que l’Afrique est damnée .Ils voient dans cette accélération de l`histoire une aubaine qui va enfin justifier leurs prédictions les plus ténébreuses et le grand déluge qu`ils nous ont toujours promis. Ils souhaitent très fort, que l`histoire leur donne raison. Cela est fort sympathique comme démarche, mais là, aussi, l`incantation remplace la démonstration et la méthode utilisée est aussi puérile. Que reste-il alors ?
Il reste ceux qui pensent que les choses sont suffisamment graves et dictent aux autorités de la transition de ce pays de se ressaisir et rester dans les limites strictes de cette période d’exception. Une transition par essence éphémère n’a pas vocation à se lancer dans des questions de réformes contrairement aux prétentions du Conseil national de réconciliation et des réformes.
L’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. Il peut certes arriver que dans des conjonctures particulières, la législation d’un pays institue des impossibilités d’accéder à des fonctions électives à l’encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais la restriction de ce droit d’accès à des charges publiques doit alors être justifiée, notamment, par la commission d’infractions particulièrement graves. Il ne s’agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso aient, en principe, le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite qui est contraire aux textes. Interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait mais n’ayant commis aucune infraction établie, revient à instituer une sorte de délit d’opinion qui est évidemment inacceptable.
Il convient donc de donner au droit de restreindre l’accès à la compétition électorale sa portée exacte. Un tel droit ne doit pas être utilisé comme un moyen de discrimination des minorités politiques.
A cet égard, l’argument tiré de l’illégalité des changements anti constitutionnels de gouvernement ne tient pas. Si donc le principe de l’autonomie constitutionnelle et politique des Etats implique sans conteste que ceux-ci aient la latitude de déterminer le régime et les institutions politiques de leur choix, et d’adopter les lois qu’ils veulent, cette liberté doit être exercée en conformité avec les engagements que ces Etats ont souscrits en la matière. Dans le cadre particulier de la CEDEAO, on se contentera de renvoyer aux dispositions suivantes du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, conclu en 2001 :
– Article 1er g) : « L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination (…) » ;
– Article 1er i) : « Les partis politiques (…) participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie » ;
L’exclusion de pro-compaoré n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique, contrairement aux allégations des autorités de la transition. La restriction opérée par le Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher ces derniers de se porter candidats, elle limite également de façon importante le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de l’élection.
Dans son Observation générale 25, adoptée au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies déclare : « L’application effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui, à tous égards seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires. Nul ne devrait subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être porté candidat » (publié le 27 août 1996).
Souhaiter formellement une réconciliation nationale en posant des actes contraires aux engagements est contraire à la démocratie et à la volonté du peuple qui s’est soulevé contre une tentative de tripatouillage juridique. Où sont passés ces intello de la société civile, ces éminents constitutionnalistes qui passaient au peigne fin les défaillances juridiques et les enjeux des textes qu’adoptait le pouvoir Compaoré? La question mérite bien d’être posée parce que depuis la chute du pouvoir Compaoré, ces leaders de la société civile que l’opinion connait pour leur intransigeance et leur engagement pour le respect de la légalité se sont confondus dans une omerta inquiétante. Leurs réactions sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné l’Etat Burkinabé à lever tous les obstacles à la participation aux élections de tous les fils du pays sont aussi rares que les larmes d’un crocodile. Il y a aussi cette sorte de connivence de groupe qui, sans doute, oblige certains à garder le silence ou à fermer les yeux sur des dérives sidérantes. Le discours que tenaient ces connaisseurs du droit est en train de prendre, sinon a pris des allures de partialité. Une partialité qui les a certainement aveuglés au point que le nouveau Code électoral a laissé entrevoir des failles que «les forts d’hier», qui s’estiment brimés aujourd’hui, ont saisi comme un fouet pour «frapper» l’Etat burkinabè devant la cour de la CEDEAO.
Rien ne peux justifier un coup d’Etat cependant, il importe d’analyser cette tragédie dans la perspective d’une réflexion de fond sur les raisons endogènes des coups de force en Afrique ainsi que de nos rapports avec les normes et la capacité de nos dirigeants furent –ils de la transition à diriger en tenant le cap d’un objectif social pas souvent compris par le peuple mais qui dessine l’architecture de notre organisation sociale et politique future. Un Etat de droit, c’est un Etat qui se soumet au droit. Gardons nous de faire l’économie d’une réflexion substantielle en applaudissant là où on doit s’interroger et penser.
Abdourahamane TOURE  Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
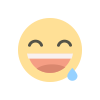 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0