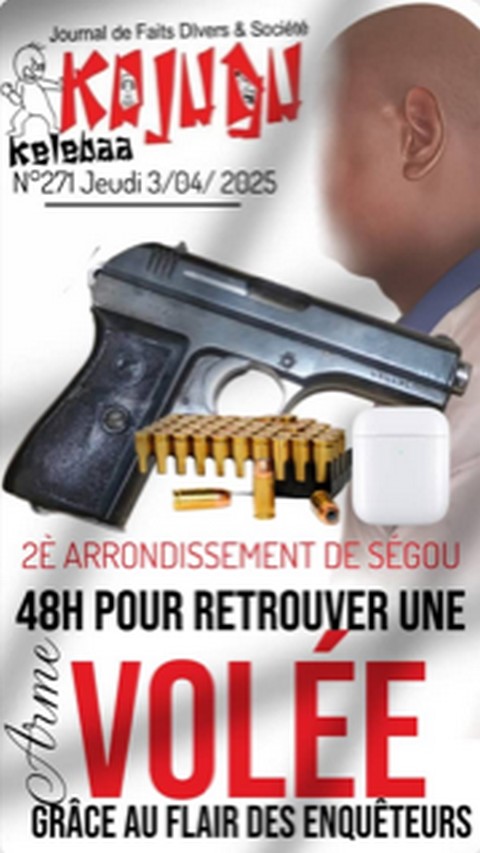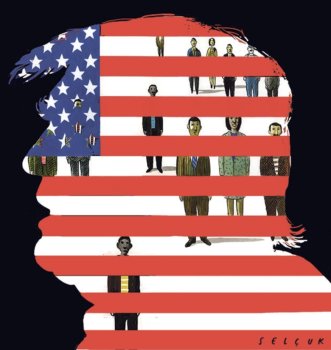-
[caption id="attachment_52703" align="alignleft" width="300" caption="Lt-col. Diaran Koné"]
 [/caption]
Quel doit être le comportement du journaliste en temps de crise ? Que doit-il dire ou écrire ? Qu’est-ce qu’il ne doit pas dire ou écrire ? Quand doit-il s’abstenir d’agir ? Le journaliste doit-il prendre partie dans un conflit ? Si oui dans quel cas ? Doit-il se censurer en temps de crise ? Spécifiquement, par rapport à la crise au Nord Mali, que faut-il dire ? Comment le dire ?
[/caption]
Quel doit être le comportement du journaliste en temps de crise ? Que doit-il dire ou écrire ? Qu’est-ce qu’il ne doit pas dire ou écrire ? Quand doit-il s’abstenir d’agir ? Le journaliste doit-il prendre partie dans un conflit ? Si oui dans quel cas ? Doit-il se censurer en temps de crise ? Spécifiquement, par rapport à la crise au Nord Mali, que faut-il dire ? Comment le dire ?
A toutes ces questions, le Lt Col. Diaran Koné, chef de la division information de la direction de l’information et des relations publiques de l’armée, apporte des réponses dans une contribution dont nous vous proposons la deuxième partie.
II – De l’information militaire
2.1. De la sensibilité d’une information (secret)
Toutes les informations ne peuvent pas être diffusées. Pour diverses raisons. L’on cite notamment le secret défense, les raisons d’Etat, la loi et les droits de l’homme, la nature d’un fait, etc. Les informations qui ne doivent pas être diffusées sont dites classifiées. Une information classifiée est une information sensible dont l’accès est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes. Cela est particulièrement observable en ce qui concerne la communication de défense. La classification donne les degrés ci-après.
2.2. Secret Défense
Réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale, et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense. Aucun service ou organisme ne peut élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des informations ou supports protégés classifiés à ce niveau, sans avoir été autorisé par le Premier Ministre ou le secrétaire général de la défense nationale (par délégation de signature). La reproduction totale ou partielle des informations ou supports protégés est formellement interdite.
2.3. Très secret défense:
Réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. Sans autorisation préalable de l’autorité émettrice, la reproduction totale d’informations ou de supports protégés n’est possible qu’en cas d’urgence exceptionnelle.
2.4. Confidentiel Défense.
Réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale, ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale classifié au niveau « Secret défense» ou « Très secret défense ».
- 3. Faut-il se censurer ?
Les identités, nationales et ethniques notamment, entraînent des guerres, des massacres et des violences. C’est dire que l’information de guerre a un caractère dramatique et émotif. En reportant et en rapportant les horreurs et images de guerre, le journaliste se retrouve en face de sa propre conscience. Sa responsabilité est entière dans sa décision prise quant au mode et à son choix de traitement. Face à une information sensible, la détermination de votre public cible (ses attentes, morale, sensibilité, culture…) vous aide dans le traitement de l’information. Qu’à cela ne tienne, le mot censure en lui-même est péjoratif. Le rôle du journaliste est-il d’amplifier ou d’adoucir les faits de guerre ? Doit-il se censurer ? La réponse à ces questions varie suivant les individus. Certains évoqueront et justifieront que la recherche de la vérité fonde le journalisme, mais en réalité ce n’est là qu’un hiatus de langage et d’esprit. Il n’existe pas la vérité, mais des vérités. Chacun a donc sa vérité. Et c’est le fondement et la justification des conflits. En fait aucune vérité n’est comme telle dissociable d’un intérêt virtuel ou apparent. Le seul fait indiscutable est que la crise focalise les drames et les émotions y afférentes que subissent ou vivent les parties. Il apparaît inopportun pour le journaliste de s’abriter derrière la quête de la vérité pour distiller des informations de nature à aggraver les plaies, les souffrances de sa société. Profession sociale, la pratique des médias s’évertuera au contraire de les panser et de les guérir. La guerre est synonyme de morts, de blessés, de déplacés, d’orphelins, veufs, veuves et bien d’autres contingences encore. Face à pareille horreur, quelle doit être l’attitude, le rôle et devoir du journaliste qui couvre ces scènes macabres? Communiquer et informer oui, mais dans le strict respect des personnes, lois et règlements. La déclaration universelle des droits de l’homme confère à chaque homme le droit de protéger son image. D’autres lois et règlements enseignent le respect de la dignité, l’honorabilité des personnes et des individus. Même la guerre a ses principes, lois et règlements. Il s’agit notamment dela Conventionde Genève et de son protocole additionnel. En ce qui concerne les professionnels des médias, au-delà des principes et conventions édictés par Reporters sans fondrières, il existe des références corporatistes régionales, sous régionales et locales. Mais dans tous les cas, la déontologie journalistique dans son application fait appel au sens humain, intellectuel et morale de chaque journaliste pris individuellement. Autrement dit, il n’y a pas à proprement parler de loi régissant l’exercice de la profession. Au Mali, la loi N°00-046 du 7 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse, (chp vI), donne quelques indications ou directives de comportement journalistique. Le reste est question de perception individuelle. Sinon il n’existe nulle part de loi sous la formule des dix commandements (tu ne ceci point, tu ne cela pas…..). La responsabilité du journaliste, toutes considérations mises à part, indexe fondamentalement la personnalité même du journaliste ( son niveau de culture, son environnement, etc.). En effet, c’est sa personnalité intrinsèque qui lui dicte sa conduite et comportement d’ensemble face aux épreuves.
III – Responsabilité et devoir des journalistes dans la gestion de la crise au Nord Mali
La responsabilité s’apprécie au travers de la pratique. Toute responsabilité a pour cadre des lois, règlements et la morale, celle-ci constituant son mode de consommation sociale.
En principe, il est demandé au journaliste d’avoir conscience de ses responsabilités sociales et politiques vis-à-vis de la société. En plus de cela, il doit faire montre d’une capacité analytique et d’une sincérité, pour ne pas dire une honnêteté intellectuelle et morale.
Dans la gestion de la crise en général qu’en est-il réellement ? Toutes ces valeurs et vertus sont-elles observées ? Quel en est le degré d’observation ?
En temps de crise, l’examen de la conscience professionnelle journalistique heurte beaucoup d’obstacles. La guerre restreint malheureusement les mouvements. De façon induite, la difficulté pour le journaliste de se rendre où il veut quand il veut limite ou influe sur sa maîtrise de la couverture événementielle. En effet, le journaliste peut-il, doit-il se retrouver sur la ligne de front ? Si l’on opte pour l’affirmative, il ya alors lieu de souligner que cela lui ôte ses habits d’indépendance, de liberté, voire de sincérité comme ce fut le cas lors de la guerre du Golf avec les journalistes intégrés ou embarqués, bien évidemment pour la cause américaine ou alliée. Sur la première ligne du front, le journaliste ne peut se départir totalement et entièrement du camp où il se trouve et qui lui assure protection, sécurité, logistique, etc. Dans un tel contexte, il devient difficile que sa vérité ne soit pas celle de son camp d’embarquement ou d’intégration. Bref, ce camp devient de fait son organe employeur. Et par voie de conséquent il se doit de défendre ses intérêts au risque de sa vie.
Si l’on opte pour le non, il faut alors souligner que le journaliste ne récoltera que des informations de seconde main, autrement dit des informations passant par le filtre d’informateurs engagés dont le seul objectif est la desserte de leur intérêt. Même là encore son objectivité prend un sérieux coup. En somme, la difficulté d’accès à la source directe pendant la guerre influe sur l’équilibre dans le traitement de l’information de crise.
La guerre installe un environnement d’urgence. Il ne s’agit plus ou peu de compréhension intellectuelle (donc de faits) mais bien plutôt d’émotions. C’est pourquoi, très généralement les militaires jouent beaucoup sur ce dernier registre. Et nous voilà au cœur de la propagande – manipulation. Seule cette propagation émotive peut pousser le plus rapidement possible les masses populaires vers une convergence communautaire de soutien. La démarche consiste à faire percevoir la guerre ou la crise non pas comme un fait mais comme une idée avec comme objectif majeur qu’elle s’empare des masses pour devenir une force irrésistible selon l’idée de Lénine. Pendant une guerre, pour tous les membres d’une même communauté, la communication usera de l’information citoyenne ou l’on servira les intérêts de l’adversaire. Et le gouvernement malien l’a si bien compris – tard vaut mieux que jamais – que quelques jours seulement après sa prise de fonction comme ministre dela Défenseet des anciens combattants, le général Sadio Gassama et le ministre dela Communication, porte parole du gouvernement, Sidiki N’fa Konaté ont entretenu les journalistes bamakois sur la situation au Nord Mali. C’était précisément le 7 février 2012 àla Maisonde la presse. L’on peut qualifier la rencontre d’acte de communication dont l’objectif était d’inviter les confrères à ce que l’on peut appeler «information citoyenne ». En clair il s’agit pour chacun et tous de s’investir pour la défense, la sauvegarde de l’unité nationale. En résumé, la communication de confiance est un objectif du gouvernement, pendant que celle d’assurance ou de capacitance ressort des armées.
Après ce bref rappel examinons à présent quelques exemples concrets.
Pendant la crise au Nord Mali consécutive à l’attaque des casernes de Kidal et Ménaka le 23 mai 2006, l’information de la castration de nos soldats enlevés par Ibrahim Ag Bahanga avait fait le tour. Mais au fait elle n’était point fondée. Elle était à classer dans le registre de la rumeur. Comme tel elle exprimait une déconvenue, voire une hystérie collective d’un peuple face à ce qu’il jugeait « de trop et inacceptable ». Il a fallu de peu pour qu’elle déclenche une vengeance collective contre « les Peaux rouges ». Et c’était justement l’objectif recherché par Bahanga et sa clic qui s’en seraient alors saisis pour opposer à l’Etat malien et à son gouvernement les accusations de violations des droits de l’homme et des minorités, faisant oublier leurs propres crimes et exactions sur de paisibles populations civiles comme militaires. Cet exemple n’aurait aucune valeur illustrative si cette information n’avait pas été diffusée par des médias d’obédience « sudiste ». S’il y avait eu vengeance contre « Les Peaux rouges », c’aurait été de la responsabilité –ne serait-ce que morale – des auteurs de cette fausse information. Nul doute que des médias bamakois auraient répondu du délit d’incitation à la violence.
L’autre exemple nous est fourni par les récentes attaques de certaines localités maliennes du Nord Mali, en l’occurrence Aguel hoc où les assaillants ont commis des crimes crapuleux d’exécution de personnels militaires et civils et ont aussitôt mis ces images là sur la toile. Toutes les sociétés humaines vouent un respect aux morts dont une quelconque profanation constitue un sacrilège. Au-delà du fait de la mise des corps sans vie sur le Net, cet acte est crédité d’une valeur communicative. Les images affectent l’émotion, révoltent, incitent donc à une velléité punitive, vues du côté des amis. Du côté des ennemis – qui les ont probablement mises sur le Net – elles peuvent servir de preuve victorieuse, d’avertissement ou de message à tous ceux qui ne voudraient pas subir pareille sentence en cas de défaite. Alors elles s’interpréteraient comme un appel à reddition. Des médias s’en sont saisis à cœur joie pour diffuser des informations tendancieuses de nature à saquer le moral des troupes de l’armée régulière. Découvrez plutôt certaines de leurs questions : Vous combattez contre les Touareg ? Combien de militaires maliens sont morts ? Allez-vous riposter ? Quel est en ce moment l’état d’esprit de vos soldats ? Qui contrôle Aguel… ?
Fort heureusement qu’au même moment la majorité des médias maliens ont fait montre de discernement. Ils ont mis dans la balance l’unité et la cohésion nationales sans communes mesures. Mais ce relatif consensus favorise-t-il une pratique consciencieuse de la profession d’un point de vue purement déontologique ? L’on peut y répondre par l’affirmative sans sourciller. Cette propension renvoie ici à la notion même d’information, à savoir tout événement, fait nouveau ou ancien digne d’intérêt pour un public donné. La notion d’intérêt acquiert ici toute son importance, car c’est l’intérêt qui détermine, du moins module le comportement et les moyens mis en œuvre. En temps de crise les lignes rédactionnelles s’avoisinent, pour ne pas dire coïncident. Au nom de la vie sauve et de la sécurité ou possibilité de pouvoir exercer librement sa profession, les médias prennent le parti de leur nation ou leur environnement immédiat. La guerre rappelle et instruit toujours aux journalistes qu’ils sont des citoyens avant d’être des journalistes. Une telle responsabilité est d’existence. La mort ou la souffrance qui pourraient découler d’une mauvaise issue de la crise le leur impose. De mémoire d’homme l’on a rarement vu une victime poignarder son sauveteur. A défaut d’être les sauveteurs, les militaires sont considérés au moins comme les protecteurs de la communauté et des individus dont l’intérêt vital devient la survie. Les journalistes, à défaut de pouvoir prendre les armes sur le front, transfèrent cela dans et par une prise de position en faveur des protecteurs désignés et reconnus : l’armée et les militaires. Au nom donc de la communauté de destin – une éventuelle défaite militaire pouvant déboucher sur la mort de tout le monde – les plumes, jadis les plus acerbes contre l’Etat, se reconvertissent. Le constat est là. Un quotidien anti gouvernement et anti présidentiel a fini par prendre faits et causes contre les rebelles du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA).
A la lumière de ces deux exemples, certaines questions taraudent l’esprit. Y a-t-il un journalisme de guerre et un journalisme de paix ? Une question importante et cruciale pour la pratique journalistique. (À suivre)
Lt Col. Diaran Koné
Chef de la division Information de la Dirpa
 [/caption]
Quel doit être le comportement du journaliste en temps de crise ? Que doit-il dire ou écrire ? Qu’est-ce qu’il ne doit pas dire ou écrire ? Quand doit-il s’abstenir d’agir ? Le journaliste doit-il prendre partie dans un conflit ? Si oui dans quel cas ? Doit-il se censurer en temps de crise ? Spécifiquement, par rapport à la crise au Nord Mali, que faut-il dire ? Comment le dire ?
[/caption]
Quel doit être le comportement du journaliste en temps de crise ? Que doit-il dire ou écrire ? Qu’est-ce qu’il ne doit pas dire ou écrire ? Quand doit-il s’abstenir d’agir ? Le journaliste doit-il prendre partie dans un conflit ? Si oui dans quel cas ? Doit-il se censurer en temps de crise ? Spécifiquement, par rapport à la crise au Nord Mali, que faut-il dire ? Comment le dire ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
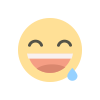 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0